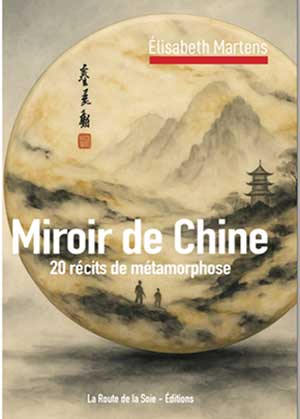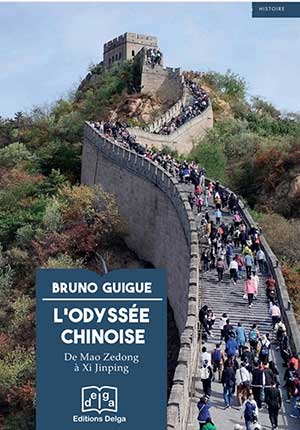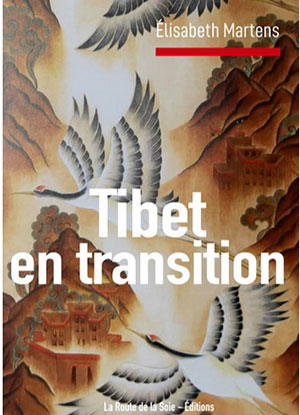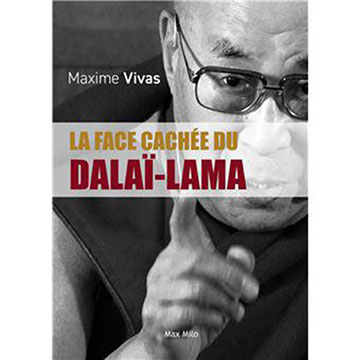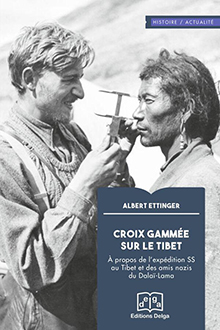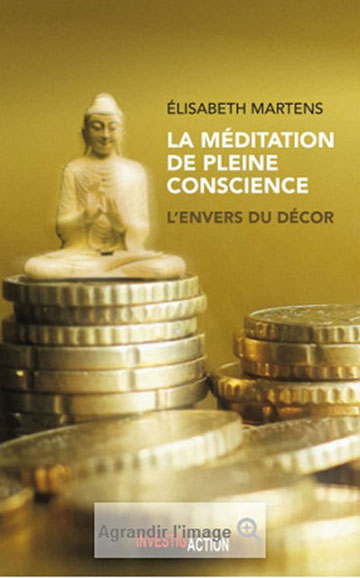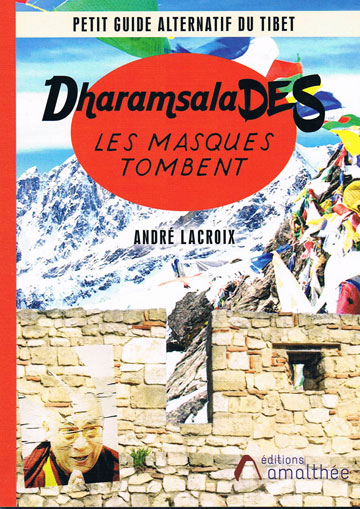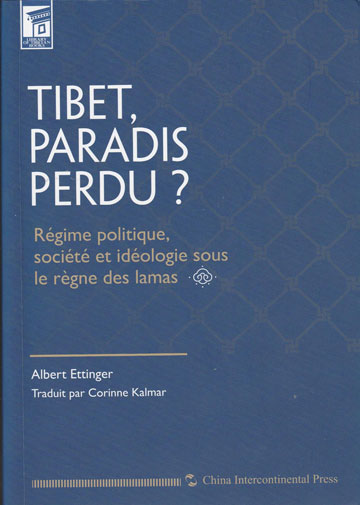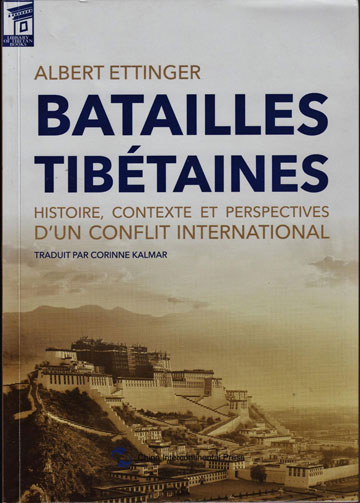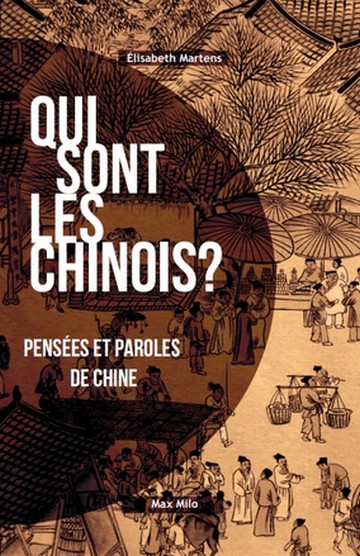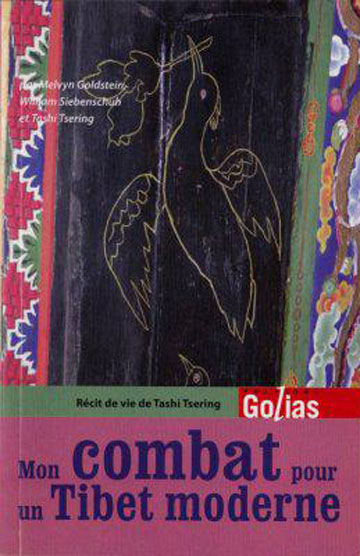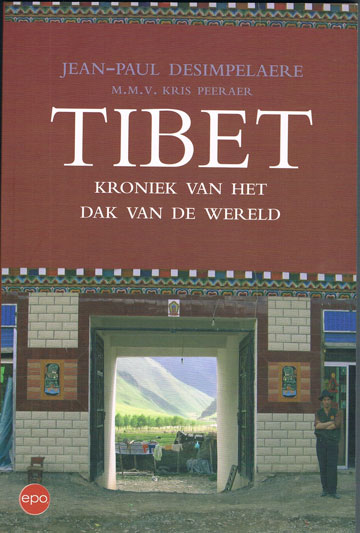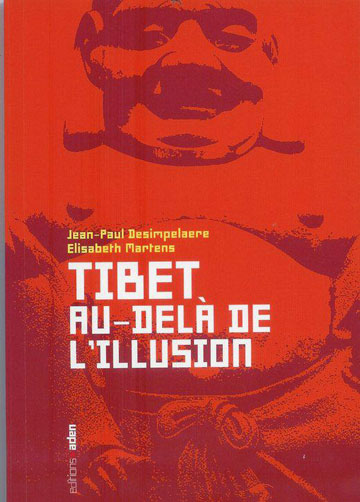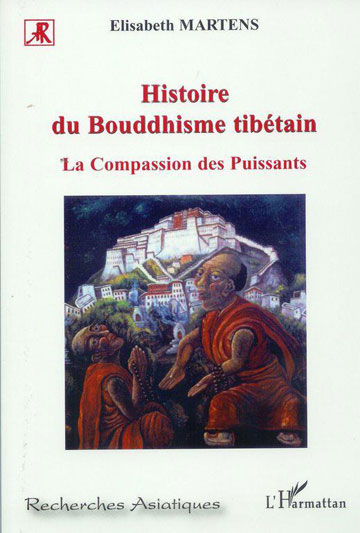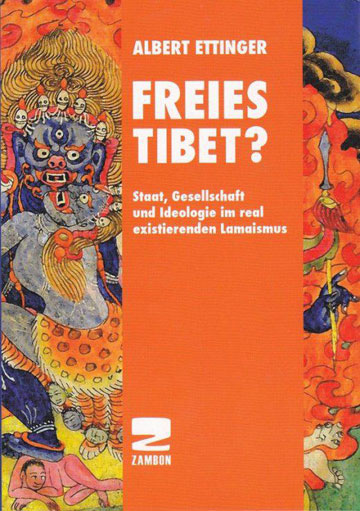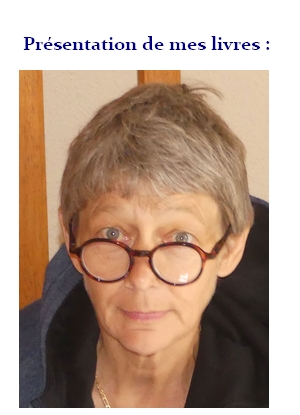Réflexions à propos de l’ouvrage de Serge Kœnig, Alpiniste et diplomate, j’entends battre le cœur de la Chine (1)
par André Lacroix, le 28 janvier 2014
Alpiniste chevronné, l’Alsacien Serge Kœnig a participé à quatre expéditions sur l’Everest. Aujourd’hui vice-consul de France à Chengdu, la capitale du Sichuan, il est la cheville ouvrière d’une sorte de jumelage entre les Alpes françaises et les montagnes de l’Ouest de la Chine.
Son livre peut être lu comme le récit passionnant, parfois haletant, d’ascensions vertigineuses, dont la fameuse opération Sagarmatha en 1988 sur l’Everest, retransmise en direct à la télévision. Mais point n’est besoin d’être un mordu d’alpinisme ou d’exploits sportifs pour dévorer cet ouvrage bien écrit. Il suffit d’avoir envie d’en apprendre davantage sur la Chine et le Tibet, grâce au témoignage d’un acteur présent sur le terrain.
Pas de langue de bois chez ce sportif arrivé tard dans la diplomatie : il aborde franchement les graves problèmes auxquels la Chine doit faire face : la corruption, l’affairisme, la pollution, etc. ; avec Amnesty International, il dénonce le contrôle de l’information par la cyber-police et la pratique de la peine de mort. Mais ‒ cela n’étonnera personne ‒ c’est surtout sa vision du Tibet, façonnée par son expérience personnelle, qui va secouer le lecteur français conditionné par l’air du temps, et qui lui a déjà valu les foudres des partisans du « Tibet libre » : certains d’entre eux ont même tenté, en vain heureusement, de saboter son projet de fonder une école de guides de montagne pour jeunes Tibétains ; l’association « France-Tibet », voyant en lui « l’horrible séide des hiérarques chinois » (p. 153), n’a pas hésité à le qualifier de « dragons aux dix mille têtes », qu’il fallait bien évidemment couper (p. 203) ; ces grands défenseurs de la liberté n’ont pas hésité non plus à s’en prendre au journaliste Philippe Rochot, coupable d’avoir fait un reportage qui ne donnait pas corps à leurs fantasmes (p. 156 et ss.).
C’est que, parmi les adeptes de la compassion bouddhiste, certains n’hésitent pas à recourir à la violence contre ceux qui, comme Serge Kœnig, se permettent de constater un certain nombre de réalités ne cadrant pas avec leurs idées reçues.
Quelques citations significatives (sans commentaire)
Menaces sur la religion ?
« En matière religieuse, pilier de l’identité tibétaine, la tutelle chinoise n’empêche pas les moines de s’adonner à leurs pratiques monastiques. Mais elle les empêche de faire de la politique » (p. 187). « À Lhassa, la fréquentation de le ruelle contournant le monastère de Jokhang témoigne même d’une recrudescence de la pratique religieuse » (p. 190).
« Mais dans l’affaire de ce jeune panchen[-lama], personne ne s’est demandé comment le ‘gouvernement’ en exil, qui est composé de fins politiques et d’un oracle d’État attitré (Nechung), qui connaît les Chinois et le dossier Chine-Tibet par cœur, a pu ne pas anticiper sur la réaction chinoise en désignant officiellement depuis Dharamsala et sans concertation préalable avec Pékin, un enfant réincarné d’un haut dignitaire du Tibet, en Chine ! Il ne faut quand même pas être devin pour savoir que, dans la situation actuelle, cela signifiait assurément ‘sacrifier’ l’enfant… et provoquer un battage médiatique sur la planète contre les Chinois » (p. 212).
Menaces sur la culture ?
« Nombre de Français défendent des identités ethniques et culturelles de pays lointains avec plus de ferveur que celles qui leur sont proches et qui se portent plus mal. Je suis beaucoup moins pessimiste sur le maintien de l’énorme héritage culturel tibétain, qui tient à cœur à beaucoup de monde » (p. 186).
« Les nouvelles demeures respectent le style local, utilisant des matériaux naturels, adaptés à l’environnement et au climat » (p. 191).
Menaces sur la langue ?
«La Révolution culturelle avait interdit le tibétain écrit, comme l’alsacien parlé (dialecte germanique) avait été interdit dans les écoles lorsque la France prit, reprit, ou libéra l’Alsace… Mais la langue locale a retrouvé de la vigueur dans les années 1980, devenant la première langue enseignée en primaire et premier cycle du secondaire » (p. 192). « Logiquement, les langues tibétaines perdureront tant que les autochtones les utiliseront dans leur vie courante, notamment pour le troc et le commerce aux confins de l’Himalaya. La langue écrite pourrait en revanche faire les frais de l’évolution et ne survivre à terme qu’à travers les activités culturelles et monastiques. La démographie ayant plus que doublé en cinquante ans et l’école étant devenue obligatoire pour les jeunes jusqu’à l’adolescence, il y a certainement aujourd’hui plus de Tibétains qui écrivent et parlent la langue de Lhassa que jamais auparavant » (p. 192-183).
Les Tibétains malheureux d’être en Chine ?
« Il faut bien considérer l’extrême âpreté des conditions de vie dans ces confins. Les autochtones accueillent comme un bienfait les récentes améliorations, même si elles ont l’odeur de Pékin. Les paysans ont les moyens d’acheter des biens élémentaires : couvertures, vestes en duvet ou simplement des pâtes chinoises pour compléter la tsampa traditionnelle. Certains acquièrent une moto, un tracteur ou une voiture. L’électricité commence à éclairer et chauffer leurs chaumières. Ils disposent de l’engrais permettant deux récoltes par an, là où leurs parents ne pouvaient presque rien faire pousser, et où leurs grands-parents devaient donner au monastère une bonne partie de leur maigre récolte » (p. 181).
Un environnement menacé ?
« Au Tibet, presque un tiers du territoire est inscrit en zones naturelles protégées (dix-huit réserves de niveau national et régional) et 10% de la superficie est couverte d’arbres. Il suffit de regarder la plaine de Lhassa : quelle différence avec le désert que j’avais observé il y a trente ans ! » (p. 256).
Mauvaises intentions de Pékin ?
« Certes, ces changements vers le modernisme ont aussi leurs revers. De nouvelles pressions succèdent aujourd’hui aux dégâts autrefois militaires et idéologiques causés dans les années 1960 et 1970. Elles sont maintenant liées au développement socio-économique qui touche l’ensemble du pays, et où le meilleur côtoie parfois le pire. Mais cela est sans rapport avec une volonté de Pékin de réduire ce Tibet » (p. 192).
Le Tibet envahi par les colons chinois ?
« Ce train [Golmud-Lhassa, inauguré en 2005] augmente les flux de visiteurs et d’hommes d’affaires, mais il favorise aussi les séjours temporaires plutôt que les installations définitives. Ceci est évidemment valable dans l’autre sens, les Tibétains pouvant plus facilement se rendre dans le reste de la Chine… » (p. 141).
Les Tibétains supplantés par les Chinois ?
« Il faudra peut-être plusieurs générations pour rattraper de siècles de retard dans l’éducation et l’enseignement, pour que les natifs soient adaptés à l’environnement du XXIe siècle et compétitifs sur le marché de l’emploi. J’ai pu maintes fois observer qu’un Chinois Han qui s’installe à Lhassa est presque assuré de trouver du travail, non parce qu’il est chinois mais parce qu’il est généralement plus qualifié » (p. 197).
« Depuis plusieurs années je songe à mener un projet sur ces hauts plateaux secrets de l’Himalaya, sur le terrain, pas forcément de grimpe, mais avec les Tibétains. Quand ? Comment ? Je ne sais pas. Mais je crois que j’ai trouvé. J’ai rencontré hier à Lhassa ce jeune homme originaire du Kham dans le Tibet-Est, Nyima Tsering (…) Son profil est celui d’un entrepreneur visionnaire qui conduit vigoureusement ses affaires en égrainant son chapelet bouddhiste » (p. 137).
Autres faits parlants (avec mon commentaire personnel)
Incidents sur le Toit du Monde vus de là-bas
Extrait du journal de bord de Serge Kœnig en date du 9 mai 2008 : « La flamme des premiers jeux Olympiques chinois était hier au sommet de l’Everest. Dans la cordée aux côtés d’alpinistes Han, Pékin a pris soin d’intégrer des minorités Hui, Tujia, Tu, et surtout des Tibétains (…) La Chine donnait ainsi au monde l’image d’une unité ethnique. Pour autant, le parcours international de cette flamme a été très chahuté, notamment à Paris. J’ai vu des Chinois échauffés par cette actualité, en colère, c’est plutôt rare. Et puis il y a eu les émeutes à Lhassa. Des étrangers évacués vers Chengdu livraient leurs témoignages, assez éloignés de ce que les médias occidentaux relayaient. J’ai pris le pouls, tendu l’oreille » (p. 47).
Ah ! si les journalistes occidentaux avaient fait de même ! Comme pour le projet d’école de Serge Koenig, on doit bien constater que beaucoup d’entre eux ont préféré recopier des dépêches venues de Dharamsala ou interviewer « une dizaine d’experts du Tibet qui n’avaient jamais mis les pieds dans cette région… » (p. 154).
Parfois même, la désinformation se double de la provocation, comme le raconte Serge Kœnig : « des touristes (…) avaient demandé [à un Tibétain] de poser avec une banderole devant le Potala et leur caméra. Seulement voilà, y était inscrit ‘Tibet libre’ en hébreu. De retour au pays, les malins avaient diffusé les images. L’agence de voyage qui accompagnait le groupe a même fermé. Être défenseur de cette cause n’est pas un antidote à la bêtise et à l’irresponsabilité… » (p. 154).
Les agences de presse occidentales ignorent-elles ou feignent-elles d’ignorer que « des organisations infiltrent le Tibet en promettant cent yuans par jour (environ 10 euros) à des Tibétains qui s’engageraient dans la bagarre antichinoise » (p. 201) ?
La gestion du terrible séisme du 12 mai 2008
Trois jours plus tard, Serge Kœnig était dans son bureau de Chengdu quand les murs ont commencé à trembler : un très violent tremblement de terre venait de se produire, à seulement quatre-vingts kilomètres de là. Il allait coûter la vie à 90.000 Sichuanais. Serge Kœnig ne tarit pas d’éloges quant à la manière dont les secours se sont organisés : « Les cent mille soldats envoyés sur le terrain ont été extrêmement efficaces face à l’un des plus grands sinistres naturels de l’histoire de la Chine » (p. 15).
Remarque personnelle : les sauveteurs sont venus au secours des populations sinistrées, sans se demander s’ils étaient Han, Tibétains ou Qiang. Quand on se souvient de la lamentable gestion par les autorités américaines de l’Ouragan Katrina, en 2005, qui a surtout touché les habitants noirs, on est en droit de se demander si les droits de l’homme ont la même signification dans toutes les parties du monde… Serge Koenig note fort à propos : « Comme les nations n’ont pas les mêmes systèmes de valeurs et les États pas les mêmes priorités, le concept des droits n’est pas uniformisé et les différences sont grandes dans les interprétations et les applications » (p. 216).
Persistance et modification de coutumes ancestrales
En stage avec ses élèves alpinistes (qu’il appelle les kids) non loin de Lhassa, Serge Kœnig remarque : « Dans le ciel, les vautours tournoient en permanence car les rites funéraires traditionnels sont toujours en vigueur, offrant les corps de défunts en pâture aux oiseaux. Les kids n’y portent guère attention… » (p. 148).
Cet usage typique du Tibet vient sans doute du fait que le sol gelé quasi en permanence sur le Haut Plateau rend très difficile d’enterrer les morts tandis que l’absence d’arbres à partir d’une certaine altitude empêche de les brûler. Quoi qu’il en soit, cette coutume du « sky-burial » a été très difficile à accepter par les Chinois habitués depuis des millénaires à pratiquer soit l’inhumation soit la crémation, au point de constituer le thème principal d’un très beau roman, Funérailles célestes (éd. Ph. Picquier, 2005), dû à la romancière chinoise Xinran. S’il est vrai que certains Chinois ont parfois tendance à mépriser la culture tibétaine, il ne faut pas en faire une généralité ; ainsi, par exemple, Miss Mei, l’institutrice des kids, «cette Chinoise fluette est passionnée de culture tibétaine » (p. 144).
Une autre pratique funéraire des Tibétains a consisté à précipiter les défunts dans les rivières, ce qui a sans doute conduit à l’interdiction de manger du poisson. Dans la plupart des guides et des relations de voyage, on peut lire que les Tibétains ne mangent pas de poisson. Certains seront probablement surpris de lire : « Dans la fermette de pierres et de terre séchée, la mère de l’un d’eux [à savoir les kids], Pemba Tendju, fait la cuisine sur un fourneau antédiluvien au milieu de la pièce unique. Elle nous prépare une assiette de poissons séchés et un thé au beurre de yack » (p. 143).
Cette « entorse » à la tradition ‒ qui était déjà répandue chez les riches Tibétains, moines de haut rang compris ‒ doit sans doute faire partie d’une diversification progressive des habitudes alimentaires des gens ordinaires, qui ne sont plus désormais condamnés à ne manger que de la tsampa et de la viande de yack ou de mouton. Grâce à l’apport technologique chinois, se sont, notamment implantées un peu partout au Tibet des serres gigantesques (très rentables étant donné l’ensoleillement particulièrement généreux du Haut Plateau) grâce auxquelles on peut trouver aujourd’hui sur les marchés une grande variété de fruits et de légumes, inconnus au Tibet il n’y a pas si longtemps.
Des églises au Tibet
Peu d’Occidentaux le savent : il existe encore dans certaines régions tibétaines des églises et des communautés chrétiennes. Serge Kœnig avoue sa surprise d’en avoir rencontré plusieurs au Sichuan (voir p. 195-196). Il mentionne en note le livre d’André Bonnet, Les chrétiens oubliés du Tibet, Presses de la Renaissance, 2006.
Je me permets pour ma part d’ajouter Les peuples oubliés du Tibet, Perrin, 2007, de Constantin de Slizewicz, un jeune reporter français qui a fait les mêmes découvertes et les raconte avec beaucoup de talent. Moi-même, en remontant le cours de la Salouen dans le nord-ouest du Yunnan en novembre 2012, j’ai pu visiter plusieurs églises toujours en activité et bien entretenues, notamment dans la préfecture autonome Lisu du Nujiang.
L’irresponsabilité d’un lama
Aux pages 132 et suivantes, Serge Kœnig rapporte un tragique accident de montagne qui s’est passé sur le Toit du Monde. « Les alpinistes attendaient impatiemment au camp de base le vieux lama du village voisin de Naa. Le religieux devait y monter pour animer le rituel de la Puja, une cérémonie traditionnelle qui lance l’ascension. Le groupe était agacé. Stol, amoureux de longue date du Népal, était embarrassé par le temps perdu, mais il l’avait accepté par respect des coutumes locales. Arrivant avec quarante-huit heures de retard, le chaman déroula se prières dans un ’froid de canard’. Après l’offrande du beurre rance, de tsampa et de bière aux divinités, le lama déclara être entré en communication avec les esprits de la montagne qui lui avaient assuré une réussite au sommet et douze jours consécutifs de beau temps. Le chaman récolta cinq cents roupies d’honoraires par personne et s’en repartit vers la vallée et son village » (p. 133). Deux jours plus tard, le temps se gâte et c’est le drame : neuf alpinistes vont trouver la mort. Revenu dans la vallée, Serge Kœnig demande des comptes aux lamas. Réponse :
« ‒ C’est le karma ! C’est de la responsabilité individuelle de chacun. Les dieux n’y peuvent rien !
‒ Mais alors, pourquoi demander aux dieux ? Pourquoi monnayer une fausse prédiction ? Pourquoi faire perdre à ces alpinistes deux jours de beau temps à attendre le chaman pour une cérémonie de bonimenteur ? … Deux jours qui auraient certainement changé leur karma… » (p. 136).
Puisque Serge Kœnig fait référence, p. 120, au Dormeur du val de Rimbaud : « Nature, berce-le(s) chaudement », il me pardonnera sûrement de faire un rapprochement entre ce récit poignant et le sacrifice d’Iphigénie, tel que le décrit le grand poète latin Lucrèce : « Tantum religio potuit suadere malorum » (« Que de crimes la religion a pu susciter ! ») (De Rerum Natura, I, 101)…
Karma et autodétermination
« J’ai essayé, poursuit Serge Kœnig, d’imaginer ce que donneraient les réponses à deux questions posées à la population : rester rattachés à Pékin ou devenir un pays indépendant … en quelque sorte un référendum au Tibet, libre de toute influence politique ou religieuse. Chimère évidemment. Eh bien je ne parierais pas sur le résultat d’une telle consultation, malgré la fierté affirmée des Tibétains, leur ciment commun qu’est le bouddhisme, et leur aspiration à plus d’autodétermination. Même si le peuple n’est pas aussi libre qu’il le voudrait aujourd’hui, les pressions de l’autorité religieuse d’autrefois ont aussi laissé leurs traces et, en définitive, il y a à gagner à être sous la tutelle d’un grand pays, stable, puissant, et qui va de l’avant » (p. 180-181).
Même si un référendum n’est pas à l’ordre du jour, l’hypothèse soulevée par Serge Kœnig mérite d’être prise en considération, car, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Si cela arrivait, si un référendum était un jour organisé sur l’avenir institutionnel du Tibet, il faudrait que la question soit bien posée de manière à persuader les Tibétains, très marqués par le bouddhisme, qu’un éventuel vote favorable au maintien dans la Chine ne pourrait pas peser sur leur karma et donc influencer leur vie future... Ne rions pas : il n’y a pas si longtemps, en Belgique (dans les années 70), je me souviens avoir vu, dans un journal « toutes boîtes » distribué avant des élections législatives, un encart émanant d’un candidat du parti social-chrétien, qui disait : « N’oublie pas que, dans l’isoloir, Dieu te regarde ! »
Un Tibet sans fantasme
« Certes, écrit Serge Kœnig, je ne me déplace pas en France avec un autocollant aux couleurs du lion des neiges sur mon sac à dos. Mais la perception de la cause de ce peuple ne peut pas être exclusive. J’aime ce Tibet. J’aime ce peuple montagnard, leur fierté, leur territoire himalayen, leur culture, leur art, leur architecture, leur hospitalité, et tout ce que j’ai partagé avec eux. Leur sort et leur futur m’interpellent profondément. Ils ne sont pas un peuple mythique ni n’habitent une terre symbolique. Ils sont comme nous, leurs enfants sont comme les nôtres, ils aspirent à grandir et à se développer, à être heureux en étant libres et respectés » (p. 180).
Cette approche réaliste et fraternelle, « au-delà de l’illusion » (selon le titre d’un lire de Jean-Paul Desimpelaere), rompant avec la « fascination tibétaine » (selon le titre d’un livre de Donald Lopez) et concernant 97 à 98 % des Tibétains (ceux qui vivent au Tibet) me paraît infiniment plus intéressante que la vision, non exempte de fantasmes revanchards, cultivée dans l’entourage du dalaï-lama et complaisamment répercutée dans les médias occidentaux.
Les défis environnementaux de la Chine et du monde
L’ouvrage de Serge Kœnig se termine sur des considérations écologiques, à la fois terrifiantes, car la survie de notre planète est loin d’être assurée, mais aussi teintées d’espoir dans la mesure où la Chine a pris conscience du problème. Exemples parmi bien d’autres : « En Chine, plus de vingt millions de ces deux-roues électriques ont été vendus en 2008 ! (…) Depuis l’avion entre Kashgar et Urumqi (Xinjiang), j’avais été impressionné par des plantations d’éoliennes à perte de vue… » (p. 258). La Chine est d’un dynamisme extraordinaire et, comme le dit Serge Kœnig, « la pratique de la voile m’a appris une évidence : il est toujours plus facile d’adapter son cap avec un bateau lancé à pleine vitesse que de faire pivoter une coque immobile… » (p. 259). « Si des traditions ancestrales font encore sens quelque part et peuvent avoir de l’influence aujourd’hui, c’est peut-être bien en Chine, où le principe d’un progrès harmonieux accolé au taoïsme et à ses ‘trois joyaux’ (la compassion, la modération, l’humilité), pourrait prendre un juste chemin… » (p.245-246).
La Chine qu’on a considérée jusqu’ici comme l’atelier de production du monde, pourrait aussi devenir son atelier de réparation. « Rien ici n’est facile mais tout est possible et imaginable. Et il faut s’attendre à ce que le nouveau modèle chinois qui surgira dans cette recherche d‘une société harmonieuse puisse surprendre le reste du monde… » (p. 251).
24 janvier 2014
Appendice : Quelques corrections (mineures) souhaitables
La perfection n’étant pas de ce monde, Serge Kœnig me pardonnera sûrement de signaler ici l’une ou l’autre petite faute à corriger lors d’une possible réimpression.
* P. 58, ce n’est pas la faim, mais la fin qui justifie les moyens, sauf peut-être en période de famine, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en Chine.
* P. 161, l’avionneur Airbus n’est plus uniquement franco-allemand. Les Britanniques, les Espagnols et d’autres en font aussi partie.
* P. 222, le Fleuve Jaune se tarit et non pas se tarie.
* P. 232, le Yarlung Tsango (ou plutôt Tsangpo ou Tsampo) n’est pas à proprement parler la « partie haute du Gange », mais plutôt son affluent. À la page 139, il est d’ailleurs dit très justement : « le Tsangpo, le fleuve qui devient le Brahmapoutre en passant en Inde ».
* P. 240, nos aïeux plutôt que nos aïeuls.
* et, pour le « fun » : ce que tout le monde, même Serge Kœnig, appelle le « beurre de yack » (voir p. 143) est en fait du beurre de … la femelle du yack, à savoir la dri. Pas plus que le bœuf ou le taureau, le yack n’est encore capable de faire du lait !
(1) Serge Kœnig, "J'entends battre le coeur de la Chine" , Éditions Glénat, 2013, collection « Hommes et Montagnes », 260 pages plus 10 pages de photos