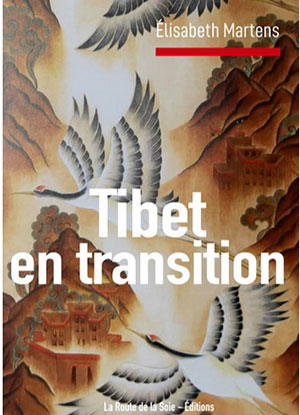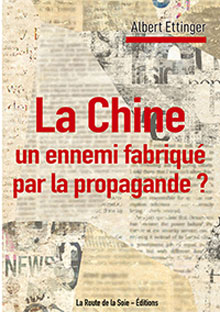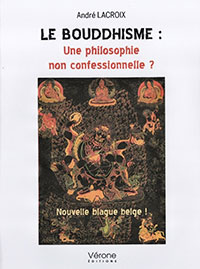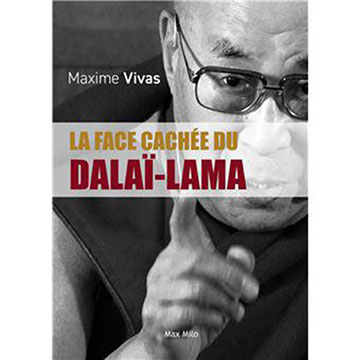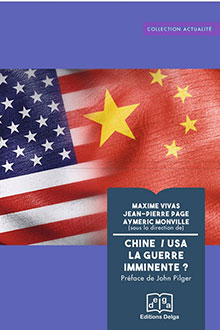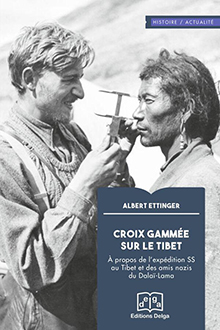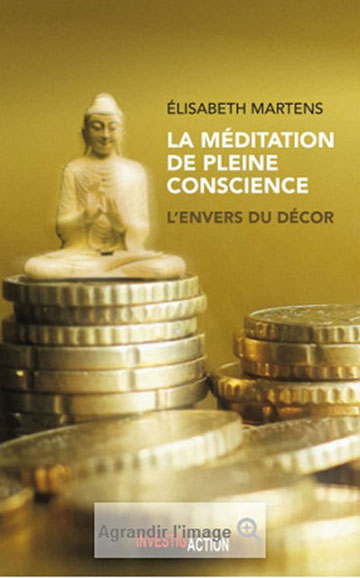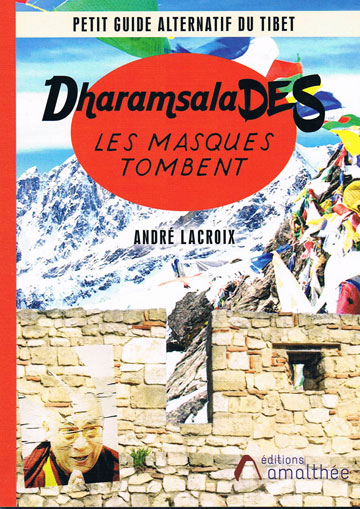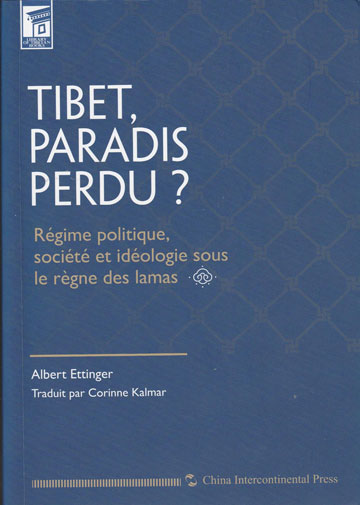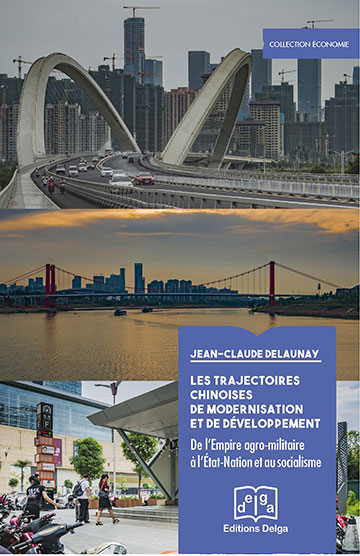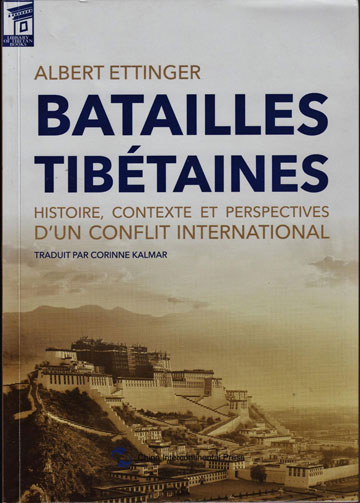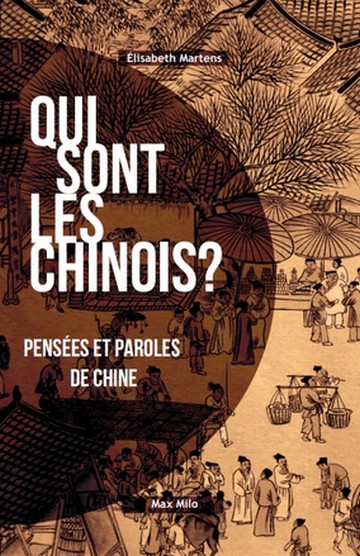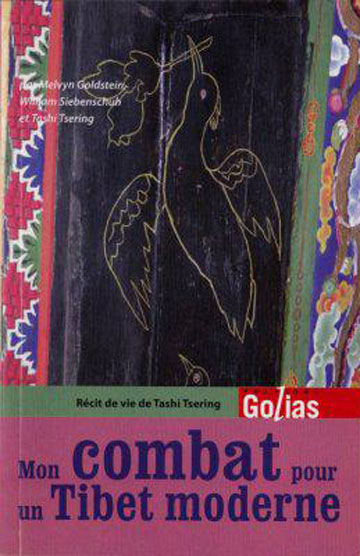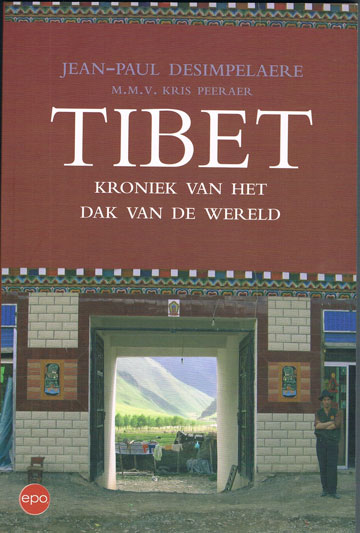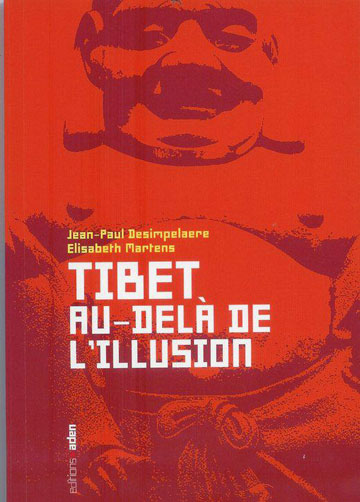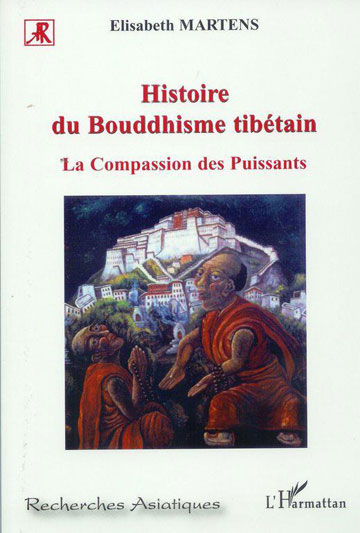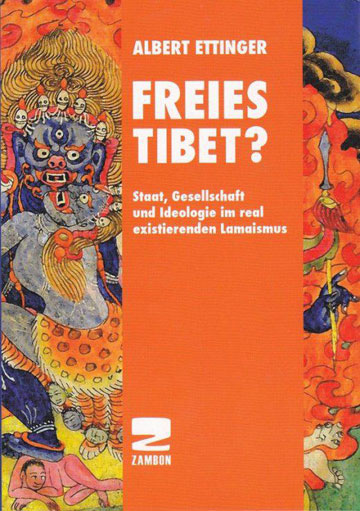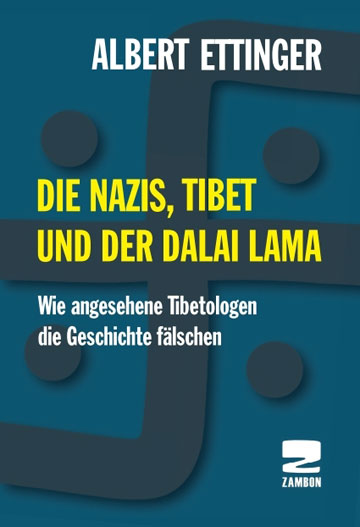Oui, trois fois oui, à la reconnaissance de la religion bouddhiste (ma réponse à Carlo Luyckx)
par André Lacroix, 1er février 2025
En réponse à mon article « Quand un groupe microscopique entend faire la loi », le Président de l’UBB Carlo Luyckx m’a envoyé un texte justificatif de 7 pages, accompagné d’une note de 2 pages, signée par le Professeur Philippe Cornu (sur la « dichotomie absurde » religion ou philosophie) et d’une note de 3 pages signée par le Professeur Louis-Léon Christians (sur le report de la reconnaissance du bouddhisme, constitutive d’ « une contrariété immédiate à la Convention européenne des droits de l’homme ») (1).

Ma motivation
Dans son premier alinéa, Carlo Luyckx me pose d’emblée une question : « Je me demande bien ce qui vous motive dans cette démarche. » Réponse simple : la volonté de partager ma conviction - acquise au cours de mes différents voyages en Asie, notamment en Chine (plus particulièrement au Tibet), et au fil de mes nombreuses lectures - que le bouddhisme est essentiellement une religion. Rien de plus, rien de moins.
Ma réflexion est totalement indépendante des prises de position du CAL dont j’ignorais même l’existence quand j’ai écrit ma brochure Le bouddhisme : Une philosophie non confessionnelle ? Nouvelle blague belge !, éditions Vérone, 2023. C’est seulement à la suite du débat contradictoire organisé à l’ULB (Université Libre de Bruxelles) par l’ABA (Association Belge des Athées) le 14/06/2023 entre Carlo Luyckx et Brigitte Steinmann, anthropologue, professeure à l’Université de Lille, que j’ai pris acte de mon accord avec les positions de la laïcité organisée.
Quand, bien des années plus tôt, j’avais appris par la presse la volonté de l’UBB de faire reconnaître le bouddhisme comme une philosophie non confessionnelle, mon sang n’avait fait qu’un tour. J’ai alors demandé à rencontrer Carlo Luyckx. Il m’a reçu fort aimablement le 16/03/2016 dans son bureau à la maison communale de Saint-Gilles, une des communes de l’agglomération bruxelloise, dont il était échevin de l’état civil et de la culture. Au cours de l’entretien, nous n’avons pas pu accorder nos violons ; j’en ai ressenti une certaine peine, car Carlo Luyckx est un personnage attachant avec lequel on n’a pas envie d’être en désaccord. Mais voilà, j’ai toujours fait mienne la formule attribuée à Socrate, Φίλος μεν Πλάτων, φιλoτέρα δε ἀλήθεια (Platon est mon ami, mais la vérité plus encore).
J’avoue avoir été quelque peu déçu par l’emploi peu amical par Carlo Luyckx d’une espèce d’argument ad hominem contre le professeur Jean Leclercq, lequel, voir p. 2, aurait « oublié », lors de la séance de la Commission Justice du 12/03/2024, de mentionner ses liens avec le CAL, comme si cette qualification était susceptible de discréditer, en quoi que ce soit, la haute valeur intellectuelle de son intervention magistrale.
Un aveu freudien ?
Toujours p. 2, Carlo Luyckx poursuit : « (…) j’avais moi-même écrit dans la revue du CAL que le bouddhisme pouvait éventuellement être considéré comme une religion sans Dieu. Ceci est toujours mon opinion. » Vous avez bien lu ? Pour Carlo Luyckx, le bouddhisme peut être considéré comme « une religion sans Dieu ». Sans doute livre-t-il là, par une espèce d’aveu freudien, sa conviction profonde qui est aussi la mienne. Et je pourrais en rester là. Mais comme il s’est fendu d’un long plaidoyer pour prouver le contraire de ce qu’il vient de dire, ce ne serait pas très correct de ma part de ne pas rencontrer ses différents arguments.
Un pesant « godsdienst »
Pour Carlo Luyckx, le bouddhisme, vu qu’il n’a pas de dieu, ne peut pas être une religion parce que « la Constitution belge dans son article 24 donne une définition restrictive aux termes ‘religion’ » et ‘religieux’ en les traduisant en néerlandais comme ‘godsdienst’ (service à Dieu) et ‘godsdienstig’. Comme la version française et la version néerlandaise de la Constitution belge ont en droit une valeur équivalente, il convient, poursuit-il, d’interpréter les termes ‘religion’ et ‘religieux’ non au sens large, mais au sens très précis de la version néerlandaise qui ne laisse aucun doute » (p. 2).
Cette phrase ne peut que laisser pantois ceux qui n’ont pas perdu leur sens critique. J’avais parlé de « blague belge » ; mais ne serait-ce pas plutôt une nouvelle illustration belgo-belge de la domination de la majorité flamande sur la minorité francophone ? Pourquoi donc sinon, alors que « la version française et la version néerlandaise de la Constitution belge ont en droit une valeur équivalente », telle version devrait-elle l’emporter sur l’autre ?
La justification donnée par Carlo Luyckx est pour le moins tirée par les cheveux. Il est bien vrai que l’article 24 de la version flamande de la Constitution belge, relative à la liberté de l’enseignement parle de « godsdienst » alors qu’elle aurait tout aussi bien parler de « religie ». Mais que peut-on en tirer logiquement ?
(*) Il faut savoir que les membres du Congrès national, ayant élaboré la Constitution belge de 1831, étaient francophones à une écrasante majorité. Par souci de cohésion nationale, ils ont fait traduire la Constitution en flamand, ce qui a donné la « Belgische Grondwet ». Pour ces constituants dont l’immense majorité n’avaient de la langue flamande qu’une vague connaissance, sinon du mépris, peu importait que le mot « religion » soit traduit par « godsdienst » ; en tout cas, la religion n’était nullement perçue comme un « service à Dieu » par les Joseph Lebeau, Charles Rogier et consorts. Ainsi replacée dans son contexte historique, la justification belgo-belge de Carlo Luyckx tombe à l’eau.
Même en supposant - quod non - qu’en 1831 « godsdienst » ait signifié « service à Dieu », l’évolution du langage a rendu cette acception complètement obsolète pour toute oreille néerlandophone. Quel chrétien flamand d’aujourd’hui, sinon peut-être une toute petite minorité bigote, pourrait définir sa religion comme un « service à Dieu » ?
Si l’on peut encore parler de service, ce ne peut être que dans le sens particulier de cérémonie, comme dans les faire-part qui parlent de « service funéraire ». C’est aussi le cas, en langue allemande, où, à côté des mots génériques « Religion » et « Glaube » (qui évoquent la piété et la foi), on parle de « Gottesdienst » en tant que service religieux, qu’il s’agisse du culte protestant ou de la messe catholique.
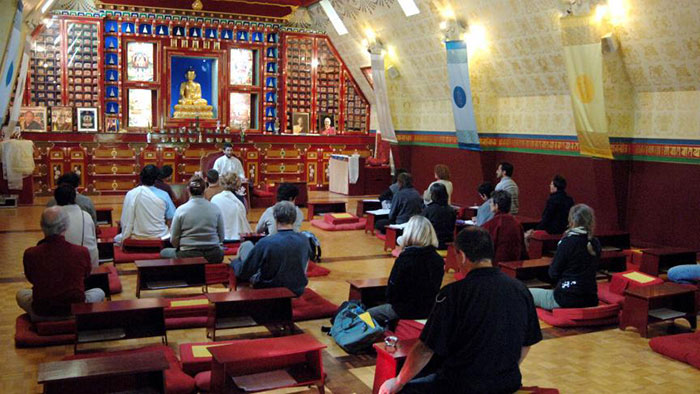
(*) Un lecteur critique m’a fait remarquer que j’avais commis ici une erreur factuelle regrettable. Ce n’est pas dans la « Belgische Grondwet » de 1831 qu’on parle, de « godsdienstige opvattingen » (= conceptions religieuses) et de « erkende godsdiensten » (= religions reconnues), mais dans sa version coordonnée du 17 février 1994, art. 24 § 1 . Il y a donc lieu de considérer comme nul et non avenu le passage situé entre « Il faut savoir (…) » et « (…) tombe à l’eau. », et, à l’alinéa suivant, remplacer « 1831 » par « 1994 ». Quant au fond, l’argumentaire reste valable. Avec toutes mes excuses (André Lacroix, 04/02/2025).
Un témoin embarrassant
Dans sa volonté de prouver que le bouddhisme ne serait pas une religion, Carlo Luyckx appelle à la barre un bouddhologue érudit et bouddhiste lui-même, Philippe Cornu, professeur émérite de l’UCL (Louvain–la-Neuve) et ex-chargé de cours à l’INALCO (Paris). Mais, comme il arrive parfois dans un procès, tel témoin cité par la partie plaignante se révèle servir la thèse de la partie défenderesse.
Je cite Philippe Cornu : « (…) le bouddhisme connaît la foi, s’appuie sur une communauté de monastiques et de laïques, utilise des rituels d’offrandes et de prières, enseigne la méditation, prône une liberté spirituelle, et en cela il s’agit bien d’une religion, c’est incontestable. Mais non pas une religion théiste, car son principe n’est pas un Dieu créateur extérieur à ses créatures mais un état d’Éveil spirituel intérieur (…) » C’est très exactement la conviction universellement admise, que je partage avec un nombre grandissant de correspondants.
Comment se fait-il donc que Luyckx et ses conseillers, quand il s’est agi de définir le bouddhisme, aient pu snober l’avis d’un expert du calibre de Cornu pour qui « il s’agit bien d’une religion, c’est incontestable » ? Seule explication à mes yeux : pour l’UBB il importait de dépouiller le bouddhisme de ses oripeaux religieux pour le faire mieux accepter, dans un monde contemporain en mal de repères spirituels, comme un simple « amour de la sagesse » (2) dont chacun(e), croyant(e) ou non, peut faire son miel.
Mais cette entreprise devrait rester en travers de la gorge de Philippe Cornu qui, dans son remarquable livre Le bouddhisme : une philosophie du bonheur ? (Seuil, 2013), montre bien que le bouddhisme n’est pas une philosophie non confessionnelle, susceptible de s’intégrer dans une religion. Sinon, il n’éprouverait pas le besoin d’attirer l’attention sur les ambiguïtés des « bouddho-chrétiens » (pp. 68 et ss.), écrivant notamment que « le Zen chrétien ne peut être qu’un Zen light » (id., p. 169). Si le Zen authentique, et plus largement, si le bouddhisme authentique n’est pas soluble dans le christianisme, c’est donc parce qu’il s’agit d’une religion distincte du christianisme, comme des autres religions.
Que le bouddhisme ait une dimension philosophique, nul ne le niera. Et Philippe Cornu de citer quelques philosophes bouddhistes célèbres « usant de raisonnements rationnels » comme Nāgārjuna, Vasubandhu, Asanga ou Candrakīrti. Nier, ainsi que le fait l’UBB, que le bouddhisme soit une religion du fait qu’il a une dimension de sagesse philosophique est aussi intellectuellement inacceptable que de nier les fondements philosophiques sur lesquels se sont construites les théologies juive, chrétienne et islamique : qui pourrait aussi nier l’envergure philosophique de Philon d’Alexandrie ou de Maïmonide pour le judaïsme, de saint Augustin et de Thomas d’Aquin pour le christianisme et d’Avicenne ou d’Averroës pour l’islam ?
Vous avez dit « pensée rationnelle » et « logique rigoureuse » ?
Est-ce à dire que les religions soient en tout point des amies de la sagesse et qu’il ne faille pas trop distinguer foi et raison ? Dans son souci de ménager la chèvre et le chou, comme un témoin se rendant compte que sa version est en train de déforcer son camp, Philippe Cornu, dans ce qui ressemble à une rétractation, poursuit : « Nous sommes là dans des catégories qui n’ont rien d’étanche avant Les Lumières et Kant. (…) Nous pouvons donc dire que le bouddhisme est à la fois une religion (…) et une philosophie de par sa pensée rationnelle qui n’a rien à envier avec la nôtre en matière de logique rigoureuse. »
Mais que penser de la rationalité des « philosophes » bouddhistes cités par Cornu : « Nāgārjuna (IIe s.) (…), entré au programme de philosophie des lycées en France en 2022 » (..) ou « Vasubandhu, Asanga, Candrakirti et bien d’autres 'qui' comptent parmi les auteurs philosophes le plus brillants de l’Inde, pour ne citer qu’eux » ?
Et que penser de leur manque d’étanchéité avec les philosophes nés avec Les lumières, ce courant de pensée qui émerge dans la seconde moitié du 17e s. avant de se développer dans toute l’Europe au 18e s. avec Kant comme figure de proue de cette Aufklärung.
Un bel exemple de la philosophie pré-kantienne européenne (dans son rôle de « servante de la Foi » !), c’est la « logique rigoureuse » des réponses données par saint Thomas d’Aquin à la question « philosophique » de savoir … « comment les corps des défunts ressusciteront le jour du Jugement dernier. Intacts, bien sûr, comme ils l’étaient de leur vivant – mais à quel moment de leur vie ? Aussi intacts qu’ils l’étaient à vingt ans, ou aussi intacts qu’à soixante ans ? Supposons qu’ils soient aussi intacts au moment de leur mort. Mais si, au moment de leur mort, il leur manquait un bras ou s’ils étaient chauves, ressusciteraient-ils dans tel état ? (…) Mais les cheveux, les doigts et les ongles des pieds seront-ils aussi ressuscités ? » (3)
Bien des siècles avant le « Docteur angélique », une autre grande figure intellectuelle de l’Église, saint Augustin, s’était déjà posé ce genre de question « philosophique » et en particulier il s’était demandé ce qu’il adviendrait d’un mort mangé par un anthropophage. Pour lui, « la chair qui a nourri le cannibale s’est certes dissoute par la suite, mais comme le Dieu tout-puissant peut récupérer ce qui a disparu, elle sera rendue à la personne dévorée : le cannibale ne l’avait pour ainsi dire qu’empruntée et doit la rendre à son propriétaire. » (4)
Avant les Lumières, ces questions étaient débattues avec sérieux par de grands penseurs, des « Docteurs de l’Église ». Elles étaient considérées comme des questions philosophiques.
Si ces dissertations font aujourd’hui sourire, il en est d’autres qui provoquent le dégoût, comme l’infâme Malleus maleficarum (Le Marteau des sorcières c.-à-d. Le marteau contre les sorcières) dont les doctes auteurs font dériver très « rationnellement » le caractère particulièrement vicieux de la femme de « ses appétits charnels plus grands que ceux de l’homme », tout en expliquant que ses « vices sont également déterminés par la création de la première femme, formée à partir d’une côte courbe (…) tordue et comme inclinée vers l’homme. (…) Il découle ainsi de la première femme que, par nature, toutes ont une moindre foi. » À l’exception, bien évidemment, de la Sainte Vierge…
Comment ne pas faire le lien entre ces adeptes chrétiens de la « pensée rationnelle » et les « philosophes bouddhistes » comme Nāgārjuna vanté par Cornu ? Dans ses enseignements consignés dans sa « Précieuse Guirlande des avis au roi », Nāgārjuna reprend à son compte les pires propos misogynes popularisés dans l’épopée bouddhiste des Jātaka : « Un sexe fait de méchanceté et de ruse (…) la femme prend la vérité pour le mensonge, le mensonge pour la vérité. Aussi avidement que les vaches cherchent de nouveaux pâturages, les femmes, insatiables, aspirent à un compagnon sur un autre. Aussi instables que le sable, aussi cruelles que le serpent, les femmes savent tout ; rien ne leur est caché. »
Quand Cornu écrit que le bouddhisme est non seulement une religion mais aussi « une philosophie de par sa pensée rationnelle qui n’a rien à envier avec la nôtre en matière de logique rigoureuse » et que « opposer religion et philosophie est tout particulièrement un non-sens lié en grand partie à la méconnaissance de la pensée de l’humanité hors du cadre historique européen classique et moderne », je comprends mieux encore la méfiance des tenants de la laïcité organisée à propos d’une « philosophie non confessionnelle » qui serait prête à considérer comme rationnels des systèmes de pensée à ce point opposés aux Lumières.
Pour tenter de mettre sur le même pied la laïcité et le bouddhisme, Carlo Luyckx fait remarquer, non sans raison, que le rituel n’est pas le monopole du bouddhisme : « Pour ce qui concerne le rituel et le cérémoniel, notre vie en société en est rythmée. Dans le sport, dans la diplomatie, la politique, les universités, l’armée, la magistrature, la culture, les loisirs, l’associatif, le travail, etc., le rituel est omniprésent. Le Centre d’Action Laïque en est conscient et y recourt sans que cela indique une quelconque religiosité » (p. 4). Et plus bas, toujours p. 4, il s’attache à relever un certain nombre de pratiques communautaires en usage dans la franc-maçonnerie « que l’on pourrait comparer à la Sangha dans le bouddhisme. »
Mais ce faisant, Carlo Luyckx ne branche-t-il pas un spot sur un détail, en laissant dans l’ombre l’essentiel ? Dans ma petite brochure (5), j’ai relevé pas moins de dix tares que le bouddhisme partage avec les autres religions et qui, à ma connaissance, ne concernent que très peu la franc-maçonnerie :
1) Prosélytisme allant parfois jusqu'à la violence contre les non-adhérents
2) Compagnonnage avec la droite et même l'extrême droite
3) Violences internes
4) Pratiques sexuelles aberrantes
5) Misogynie
6) Obsession de l'enfer et des châtiments post mortem
7) Récompenses promises après la mort contre espèces sonnantes et trébuchantes
8) Financement douteux
9) Prises de position rétrogrades, voire abjectes
10) Formalisme hypocrite.
Que je sache, contrairement aux usages de toutes les religions, il n’existe pas de reliques d’Aristote, d’Hypatie, de Spinoza ou de Voltaire, auxquelles rendre un culte…
Religion et libre examen
À l’appui de sa thèse, Carlo Luyckx tente une échappatoire à ce constat peu glorieux en écrivant : « Le Bouddha Gautama lui-même est cité dans le Kamalasutra pour avoir dit qu’il ne faut pas croire quelque chose parce que c’est écrit dans les livres saints ou enseigné par des personnes considérées comme des sages, qu’il ne fallait même pas croire ce qu’il disait lui-même, mais qu’il fallait investiguer, réfléchir et essayer de comprendre » (p. 2).
Fort bien, mais n’est-ce pas ce que disent aussi des penseurs chrétiens comme Gabriel Ringlet, dans L’Évangile d’un libre penseur ? Cela suffirait-il à faire en sorte que le christianisme ne soit plus une religion ? Non, bien sûr. De même, la soi-disant libre-pensée du Bouddha est impuissante à démolir l’équation : « Bouddhisme = religion ».
Et, par ailleurs, sur le terrain de l’engagement sociétal, qu’il puisse se trouver, en Asie, des moines bouddhistes intervenant dans des meetings politiques, c’est bien au nom de leur foi qu’ils se mobilisent. On peut en dire autant des chrétiens s’impliquant dans des combats socio-politiques au nom de la Théologie de la Libération. Je connais pas mal de proches qui vivent le christianisme comme une simple conformité aux préceptes évangéliques : ça ne change rien au fait que le christianisme est une religion. Et que dire alors des juifs libéraux pour qui le judaïsme se réduit à un héritage culturel : ça ne change rien au fait que le judaïsme est une religion. On trouve des Bouddhistes, comme Carlo Luyckx précisément, qui se sont engagés dans un mandat politique : ça ne change rien au fait que le bouddhisme est une religion.
Remarque toute personnelle au passage, sur l’imprévisibilité de l’histoire : je pense que l’intuition originale attribuée à Bouddha de l’impermanence de l’existence et de sa rupture avec le polythéisme ambiant n’était pas condamnée à devenir une nouvelle religion, pas plus que les enseignements émancipateurs de Jésus par rapport à la Loi de Moïse n’étaient condamnés à devenir une autre nouvelle religion. Comme en écho à Bouddha qui aurait fait appel à l’esprit critique, Jésus, si l’on en croit l’évangile de Luc (12,57), n’avait-il pas demandé à ses contradicteurs : « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? » Si les enseignements de Jésus sont devenus le christianisme et si les enseignements de Bouddha sont devenus le bouddhisme, c’est probablement à cause de la propension humaine à préférer le confort rassurant d’appartenir à une communauté de croyants plutôt que d’affronter personnellement, comme Épicure ou Lucrèce, l’angoisse existentielle sur le sens de la vie et de la mort.
Pour en revenir à Carlo Luyckx, celui-ci poursuit sa présentation d’un bouddhisme « décléricalisé » en déclarant que le dalaï-lama « n’est certes pas une sorte de pape » (p. 2). C’est vrai : ce dernier n’a autorité que sur une toute petite minorité des bouddhistes du monde. Il n’empêche que « Sa Sainteté » peut se comporter comme un pape au sein de sa petite secte des bonnets jaunes, par exemple en condamnant et en persécutant des « hérétiques » comme les adeptes de la vénération de la déité Dordje Shougden.
Une conception européo-centrée du bouddhisme ?
Dans mon article « Quand un groupe microscopique entend faire la loi » (6), je me demandais si, en se ralliant aux thèses de l’UBB chères aux Belges convertis au bouddhisme, les Bouddhistes de Belgique provenant d’Asie n’auraient pas été instrumentalisés dans un climat néocolonialiste européo-centré. Voici la réponse de Carlo Luyckx : « Le choix de la reconnaissance non comme religion, mais comme philosophie non confessionnelle a été fait à l’unanimité en 2006 et continue à l’être à chaque AG par les 40 associations membres, incluant des ressortissants de tous les pays bouddhistes » (p. 3). Dont acte.
Je ne conteste pas ce fait, mais je continue à me demander ce qui a bien pu amener des Bouddhistes venus du Vietnam, du japon, du Myanmar, d’Inde, du Sri Lanka ou du Bhoutan, à se rallier, une fois sur le sol belge, à une vision rompant radicalement avec celle de leur famille spirituelle d’origine.
Dans sa réponse, Carlo Luyckx ajoute ceci : « La qualification du bouddhisme comme 4ème religion mondiale est justement le fruit de l’interprétation des colonisateurs britanniques basée uniquement sur les signes extérieures vus à travers des lunettes abrahamiques eurocentristes » (p. 3). Mais comment des colonisateurs (ou des missionnaires) britanniques (ou français) (7) auraient-ils pu appeler autrement que religion ce qu’ils avaient sous les yeux : des temples, des pagodes, des monastères, des moines, des processions, des offrandes sur des autels, etc., etc. ? Ils n’avaient nullement besoin de « lunettes abrahamiques ». La classification du bouddhisme comme religion n’est en rien une initiative occidentale comme le prétend Carlo Luyckx : ça fait des siècles qu’en Chine et c’est toujours d’actualité en RPC le bouddhisme fait partie des religions reconnues, avec le taoïsme, l’islam et le christianisme sous les formes de protestantisme et de catholicisme.
Et le Conseil d’État ?
Carlo Luyckx fait grand cas de l’avis du Conseil d’État du 12 juin 2023 pour qui « Le choix de la reconnaissance entre un culte et une organisation philosophique non confessionnelle est une question interne à ce culte ou cette organisation philosophique non confessionnelle. » Traduction « journalistique » du Vicaire général de Liège, Éric de Beukelaer : « Ici, c’est le juriste que je suis qui parle : on ne peut tout à la fois prôner la stricte séparation entre les religions et l’Etat et demander à l’Etat de se prononcer dans une question de théologie interne à cette communauté. Non, ce n’est pas à l’État de déterminer si une conviction de vie est ‘religieuse ou non’ » (8).
Première remarque : même s’ils sont d’un grand poids, les avis du Conseil d'État n'ont pas de force juridiquement contraignante. La constatation – souligne Carlo Luyckx à la p. 3 – que « cet avis (…) a été adopté à l’unanimité en Assemblée générale, section législation, toutes chambres réunies » n’y change rien. Peut-être serait-ce justement l’occasion ici de suivre le conseil du Bouddha : « il ne faut pas croire quelque chose parce que c’est écrit dans les livres saints ou enseigné par des personnes considérées comme des sages »…
Deuxième remarque : la tendance à restreindre le droit de l’État d’intervenir dans une question philosophique, théologique ou morale est peut-être dans l’air du temps ; elle n’en est pas moins contestable. Supposons un maraîcher qui afficherait « Poires délicieuses » sur un cageot de pommes : les autorités du marché ne seraient-elles pas habilitées à lui enjoindre de mettre fin à cette tromperie sur la marchandise ? L’UBB a beau afficher « Philosophie non confessionnelle » ; le bouddhisme n’en est pas moins pour autant, ontologiquement, une religion.
Troisième remarque : le Droit - toujours soumis à différentes interprétations - n’est pas la seule instance à être prise en compte pour en décider. D’autres sciences humaines sont aussi habilitées à cerner le problème, comme l’histoire, la politologie et, singulièrement, la sociologie. C’est ainsi que la sociologue française Nathalie Heinich énumère quatorze fonctions qui caractérisent les religions : les fonctions séparatrice, figurationnelle, rituelle, sotériologique, thaumaturgique, cultuelle, sacrificielle, mystique, charismatique, communautaire, éthique, culturelle, institutionnelle et politique. (9) Or le bouddhisme coche toutes les cases...
Un retard regrettable
Même si la patience est une vertu éminemment bouddhiste, on peut comprendre l’agacement de l’UBB : selon le Professeur Louis-Léon Christians, appelé à la barre par Carlo Luyckx : « Tout délai raisonnable est écoulé depuis longtemps. 18 ans ont passé depuis la première demande, et 16 ans depuis la ‘pré-reconnaissance’. Tout délai complémentaire constituerait une discrimination envers l’Union Bouddhique. »
Mais à qui la faute ? Si le bouddhisme belge avait demandé à être reconnu au même titre que les autres cultes reconnus, à savoir les cultes catholique (1830), israélite (1830), anglican (1835), protestant-évangélique (1876), islamique (1974), orthodoxe (1985), il aurait obtenu gain de cause depuis belle lurette. Et ce n’eût été que justice.
Comme le note la juriste Stéhanie Wattier, professeure à l’Université de Namur, « les reconnaissances ont toujours été le fruit d’une sorte de ‘pratique administrative’ assez informelle entre le SPF Justice et les cultes et organisations non confessionnelles. » (10) Vu cette propension bien belge à trouver des arrangements en marge d’un cadre juridique, peut-on imaginer que cela aurait constitué un problème d’ajouter le bouddhisme au club des cultes reconnus ? Qui aurait pu s’y opposer ? Quel évêque, quel prêtre, quel pasteur, quel rabbin, quel imam ? Quel représentant de la laïcité organisée ? Et même quel gouvernement, qui aurait été tout heureux de jouer un rôle confortable de notaire, en ajoutant une plume à son chapeau ?
Personnellement, j’aurais été le premier à m’en réjouir.
Sources :
(1) Ces trois documents sont disponibles sur demande à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
(2) selon l’étymologie de φιλοσοφία / philosophía, mot composé de φιλέω/ philéô, «aimer», et de σοφία/sophía, «sagesse, savoir».
(3) Voir la quaestio 80 du Supplementum de la Summa Theologica.
(4) De civitate Dei, XXII, 20, 4.
(5) Le bouddhisme : une philosophie non confessionnelle ? Nouvelle blague belge !, éd. Vérone, 2023.
(6) https://tibetdoc.org/index.php/religion/bouddhisme-tibetain-dans-le-monde/781-quand-un-groupe-microscopique-entend-faire-la-loi.
(7) Voir par exemple, le témoignage du missionnaire français Évariste Huc, constatant, dès son arrivée au Tibet au milieu du 19e siècle, les multiples similitudes entre les cérémonies bouddhistes et le culte catholique (in Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet suivis de l’Empire chinois, nouvelle édition chez Omnibus, 2001).
(8) courriel d’Éric de Beukelaer du 13/07/2024 réagissant à mon commentaire de sa chronique publiée le 09/07/2023 par La Libre Belgique du 09/07/2024 sous le titre polémique : « Laïcité : quand le chien berger devient enragé » (https://www.lalibre.be/debats/opinions/2024/07/09/laicite-quand-le-chien-berger-devient-enrage-YB3KRUCWJBD4BIOR2ZLULW2VB4/).
(9) Voir https://www.revue-interrogations.org/Pour-en-finir-avec-le-religieux.
(10) https://www.lesoir.be/503858/article/2023-04-01/carta-academica-reconnaissance-du-bouddhisme-ou-en-est-concretement-dun-point-de