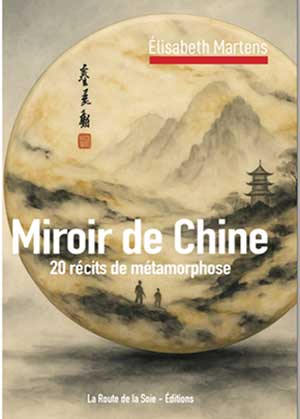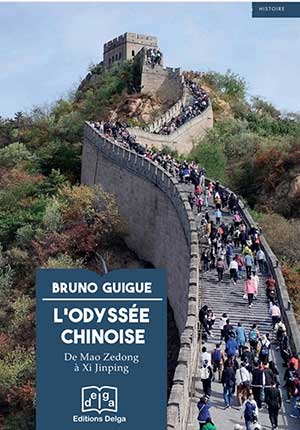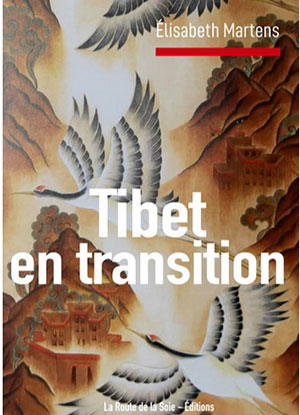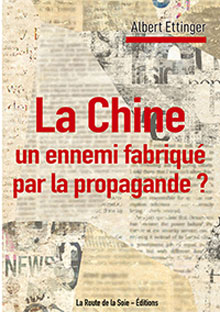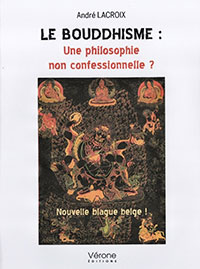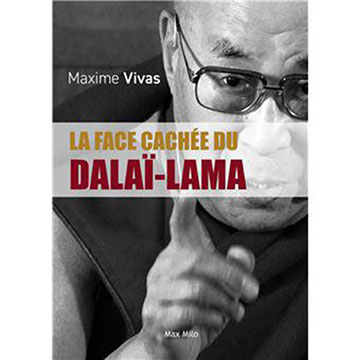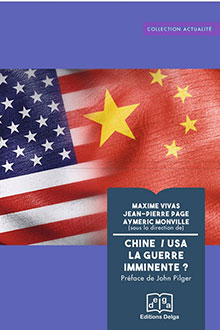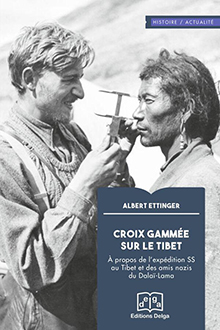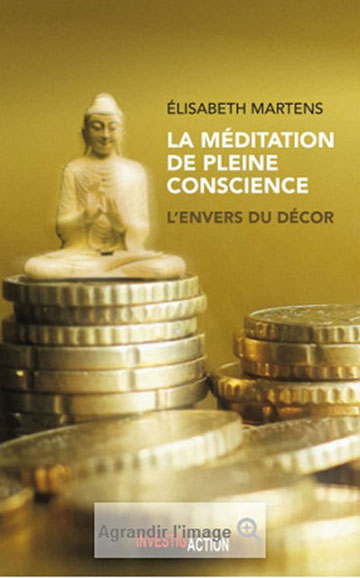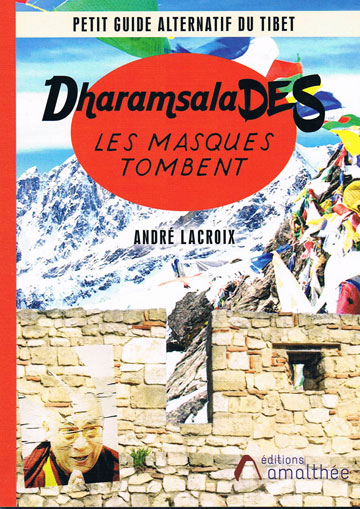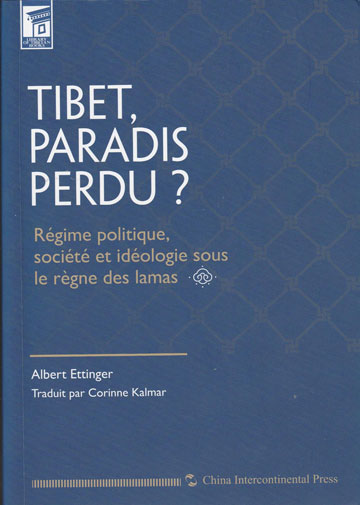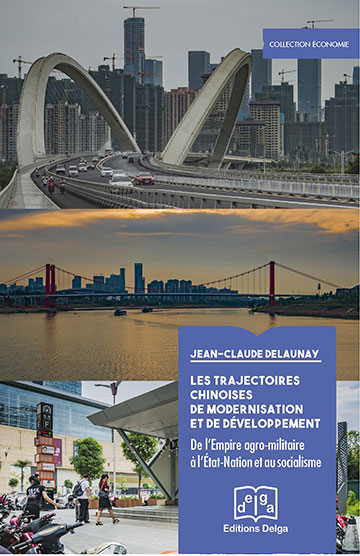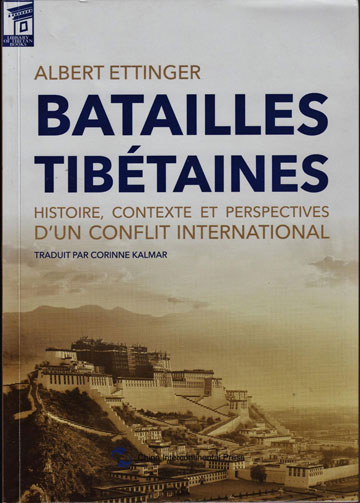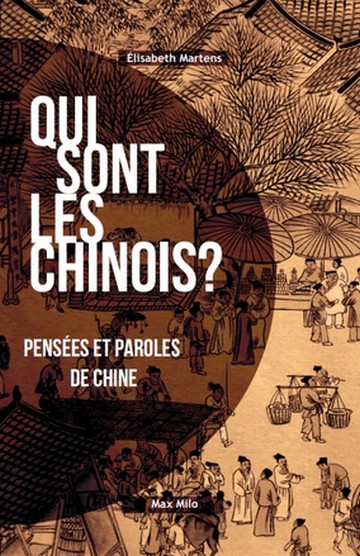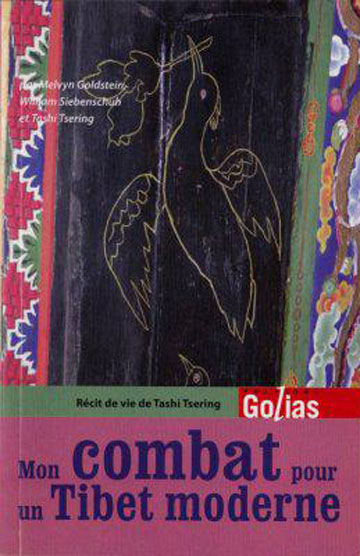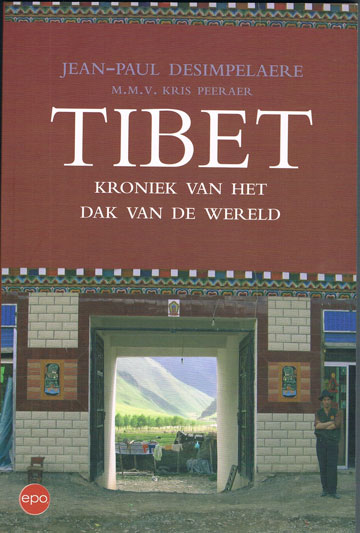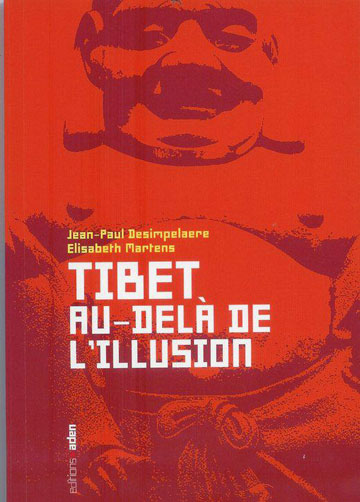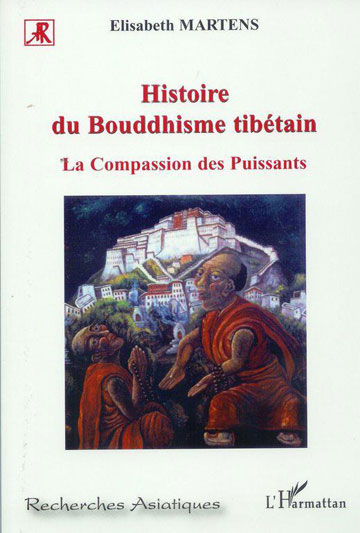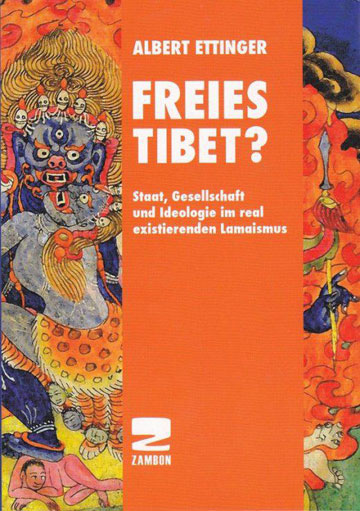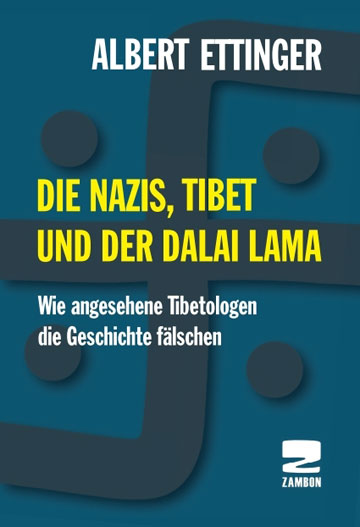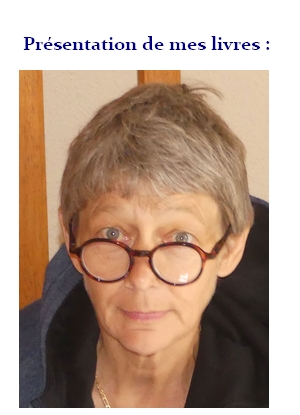Un OVNI au Tibet - Recension du livre Tibet en transition d’Élisabeth Martens
par André Lacroix, le 1er mars 2025
Une histoire érudite du Tibet, un portrait du Tibet d’aujourd’hui, un guide de voyage, un roman : c’est tout ça à la fois… sur 750 pages. Si Sonia Bressler, des éditions La Route de la Soie, a pris le risque de publier ce gros volume, ce n‘est pas pour rien. Impossible de rester indifférent face à un tel OVNI.
Pendant un mois et demi, à l’automne 2019, Élisabeth Martens, qui n’en était pas à son premier voyage au Tibet, est partie à la découverte de régions très peu visitées par les touristes : après une boucle autour de Lhassa, elle est partie plein ouest vers le Mont Kailash par la route longeant l’Himalaya, puis elle est remontée au nord dans l’ancien royaume de Gugé avant de repartir vers l’est en traversant le parc national de Changtang et puis de repiquer au sud vers Lhassa.
Le livre est constitué de sept parties, subdivisées chacune en petits chapitres – il y en a 52 au total – allant de 7 à 30 pages, aux titres évocateurs, comme « Les colères du Drepung », « Sakya, la belle », « Nyima, la métisse », etc., etc.
Vu son poids (plus d’1 kg), Tibet en transition ne constitue pas un guide voyage des plus pratiques (!), même si, comme dans tout guide qui se respecte, il fournit une série d’informations précieuses sur la géographie physique et humaine, sur les faits historiques et les légendes, sur les sites remarquables et les croyances religieuses, sur la société actuelle et les enjeux géopolitiques, etc. En particulier, ce guide constitue pour les ornithologues et autres spécialistes de la faune et de la flore, une mine d’informations impressionnante : on sent que l’autrice est diplômée en biologie.
De sa formation universitaire, elle a gardé le souci de l’exigence intellectuelle : les notes de bas de page sont presque aussi nombreuses que les pages elles-mêmes. Tant d’érudition pourrait être lassante. Il n’en est rien, car Élisabeth Martens est aussi une véritable écrivaine, voire une poétesse quand elle tombe sous le charme des beautés indescriptibles du Haut Plateau. Elle écrit comme les mots lui viennent, d’où la présence, ici et là, de belgicismes plutôt pittoresques (drache = averse, aubette = abribus, minerval = frais scolaires, se racrapoter = se recroqueviller, etc.).
Si le lecteur arrive sans peine au bout d’un tel volume, c’est parce que sa docte autrice fait aussi montre de véritables talents de narratrice, sachant mettre en scène les interactions entre les protagonistes de son récit, car elle n’était pas seule, bien sûr, pour parcourir les 2.500 kilomètres du périple. Ses trois compagnons de voyage deviennent sous sa plume des personnages de roman, aux traits bien campés, à commencer par son vieil ami photographe plein de bon sens, qu’elle a surnommé Zbig en mémoire de ses origines polonaises. Il y avait aussi deux Tibétains aux traits contrastés : Tsoepel, le guide très compétent dont les parents avaient appartenu à la classe aisée et qui ne perdait pas une occasion pour dire toute le mal qu’il pensait des Chinois Han, et Pemba, le chauffeur, d’origine plus modeste, mais ayant fait d’excellentes études, qui, lui, était reconnaissant pour tous les progrès effectués depuis la chute de l’Ancien Régime. Il y avait encore, planant au-dessus de ce quatuor, la présence-absence de Jean-Paul, le mari et le grand amour d’Élisabeth, décédé en 2013, avec lequel elle avait découvert et parcouru le Tibet au cours de voyages mémorables. Parsemant le récit, surgissent ainsi de temps à autre des souvenirs personnels de ce personnage peu banal, qui donnent à la narration une dimension émouvante.
Ajoutez à ces personnalités ainsi dessinées, un sens du dialogue peu banal et voilà comment on arrive sans peine au bout d’une grosse brique apparemment indigeste. Au cours des kilomètres parcourus dans une robuste 4x4, on a tout le temps pour assister aux chamailleries entre le guide et le chauffeur, et pour écouter soit les chants bouddhistes de Dadon, la vedette tibétaine exilée aux États-Unis, qu’affectionne Tsoepel, soit les morceaux de rock en vogue à Lhassa, qui ont la faveur de Pemba. Ainsi passent les longues heures de route.
Le mieux, sans doute, pour nous lecteurs, c’est de mettre aussi le temps pour effectuer le voyage, sans avoir peur de perdre le fil. Pas de panique : si nous ne savons plus qui est tel personnage historique ou tel héros de légende, si nous avons oublié à quoi correspond tel ou tel terme, les notes de bas de page, qui parfois se répètent, sont là pour nous rafraîchir la mémoire. Et si un doute subsiste, on peut recourir au lexique d’une cinquantaine de pages qui clôt le volume.
Ainsi on découvrira ou on redécouvrira Lhassa et ses sites bien connus : le gigantesque Potala, le temple du Jokhang, le palais d’été du Norbulingka, les monastères de Drepung et de Sera, avant de parcourir le « grenier des rois », avec notamment la citadelle du Yambulakang, les monastères de Samyé, de Tashilumpo. Ensuite, on va emprunter la route des sommets en longeant l’Himalaya et en saluant l’Everest, disons plutôt le Qomolangma, la « déesse du monde ». Et puis c’est le pèlerinage au Mont Kailash, près duquel prennent naissance quatre grands fleuves : au nord la Source du Lion, l’Indus, à l’ouest la Source de l’Éléphant, le Sutlej, au sud la Source du Paon, le Ghaghara, affluent du Gange et à l’est la Source du Cheval, le Yarlung, futur Brahmapoutre. Tous ces noms, et bien d’autres encore, sont porteurs de légendes que Tsoepel rapporte avec brio et que Zbig se fait parfois un malin plaisir de ramener au ras des pâquerettes.
On en est alors à l’extrémité de la boucle et déjà à la moitié du voyage et on va entrer dans l’ancien royaume de Gugé, « l’autre Tibet », une civilisation datant du 2e millénaire avant J.-C., où est née la religion Bön et par où a pénétré, venant d’Inde, le bouddhisme qui allait finalement prévaloir sur la religion primitive sans jamais l’évincer totalement. « Quel beau dimanche au royaume de Gugé ! », tel est le titre du chapitre le plus long du livre (pages 441-471). En se promenant à Tsparang, la capitale de l’ancien royaume, nos voyageurs tombent nez à nez avec un historien des religions d’une soixantaine d’années, bedonnant et postillonnant. On assiste alors à un exposé brillantissime, relancé par les questions des auditeurs, sur l’histoire politico-religieuse du Tibet. Son épouse, confiera-t-il à la fin, est une Chinoise Han, enseignant l’histoire de l’art à l’Université de Lhassa.
C’est aussi durant cette visite à Tsaparang (p. 468) que prendra place un incident regrettable, qui jettera un froid et dont Tsoepel ne sortira pas grandi.
Mais le voyage continue, avec, comme dans tout voyage, les tensions interpersonnelles et les confidences occasionnelles qui insensiblement nous rendent attachants les protagonistes : Tsoepel, le guide introverti, Pemba, le chauffeur critique, Zbig, l’observateur amical, sans oublier le fantôme de Jean-Paul qui se matérialise au hasard d’une rencontre ou d’un paysage évoquant le passé.
On commence alors la dernière tranche du voyage : encore mille kilomètres plein est, depuis Ali jusqu’à Lhassa, par la route parallèle à celle qui longe l’Himalaya, mais bien plus au nord. On va entrer dans le Changtang, un immense parc national, situé aux alentours des 5.000 mètre d’altitude. C’est une réserve naturelle extraordinaire qui abonde en espèces rares aujourd’hui menacées, comme l’antilope du Tibet ou chiru. Bien que protégée depuis les années 1990, elle reste une cible pour les braconniers qui revendent à prix d’or sa sous-toison sur les marchés noirs.
Avec Élisabeth Martens, on est loin d’une description de carte postale. Elle ne cache pas avoir vu ici et là des montagnes de détritus ; elle n’apprécie pas non plus le caractère inesthétique des petites villes construites à la va-vite pour remédier à un problème urgent qu’on pourrait ainsi résumer : la désertification et la croissance démographique ont entraîné un surpâturage obligeant des milliers de semi-nomades gardiens de troupeaux à se sédentariser et à trouver un nouvel emploi, que ce soit dans l’agriculture (sous serre), le bâtiment, le commerce, etc. ou surtout dans la protection de la biodiversité. Séduits par l’idée de « civilisation écologique » lancée par Xi Jinping et animés par leur philosophie bouddhiste de respect de la vie sous toutes ses formes, beaucoup de Tibétain(e)s ont trouvé, dans la protection de l’environnement, un emploi qui les gratifie et les fait vivre.
Après cette plongée en pleine nature, le retour à Lhassa constitue un contraste saisissant. Lhassa, on l’ignore largement chez nous, est devenue une ville moderne avec ses immenses centres commerciaux, leur éclairage artificiel, leurs escalators, leurs boutiques où se vendent des parfums Dior ou Chanel…
Lhassa est aussi devenue un foyer culturel prisé par les Chinois Han, avec ses librairies et ses nombreux ouvrages majoritairement en tibétain mais aussi en version bilingue tibétain-mandarin, en mandarin et même en anglais, avec ses salons de peinture où s’exposent des toiles d’un modernisme déconcertant et avec ses lieux branchés qu’il fait bon fréquenter.
Lhassa, c’est aussi une ville en partie musulmane. La réception inattendue de nos voyageurs par l’imam de la grande mosquée étonnera plus d’un lecteur. D’une voix posée, ce dignitaire musulman, issu d’une famille Hui modeste, retrace l’histoire de l’arrivée de l’islam en Chine par la route de la soie. Il précise que Lhassa compte treize mille musulmans, ce qui ne plaît pas à tout le monde. « Moi, dit-il, je pense qu’il vaut mieux vivre en bonne entente, car ici les Tibétains, les Han et les Hui, nous sommes tous serrés comme les graines dans un fruit de grenadier. »
En écho avec ces mots, lors de sa soirée d’adieu à Lhassa, Élisabeth se laisse aller à une nouvelle adresse à son mari défunt. Ce seront les dernières lignes de son ouvrage monumental :
« Assise seule sur la balustrade du Chagpori, je savoure avec toi cet instant précieux et ce vœu si délicieusement formulé par Youlan que le Tibet devienne à la fois un espace de réconciliation entre tradition et modernité, un centre de réflexion sur la place des religions dans le monde, un lieu de méditation et de contemplation, un modèle pour les recherches sur le climat et la biodiversité, une terre de respect pour le vivant. »