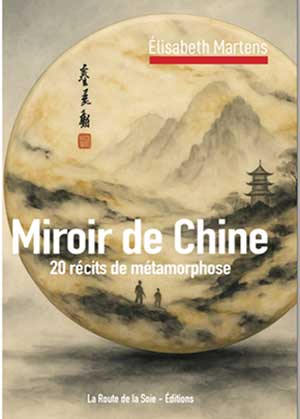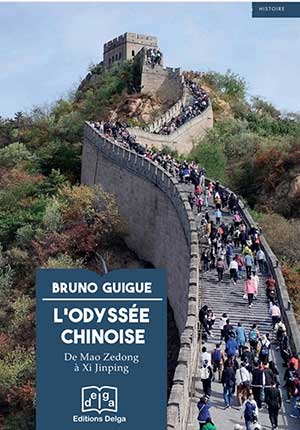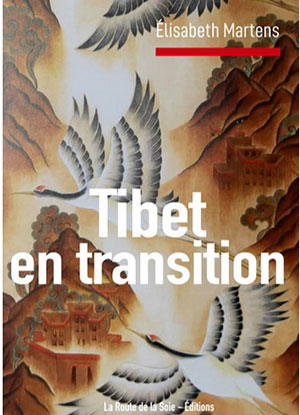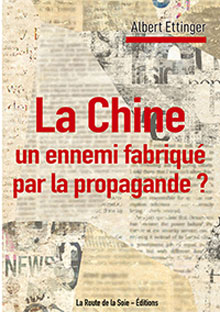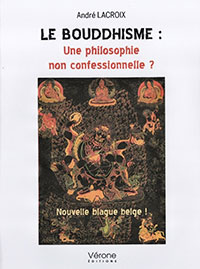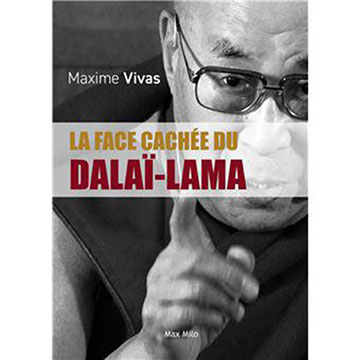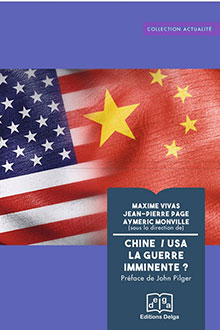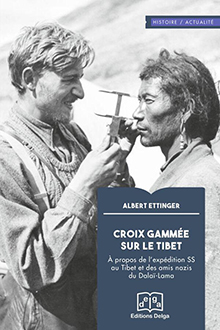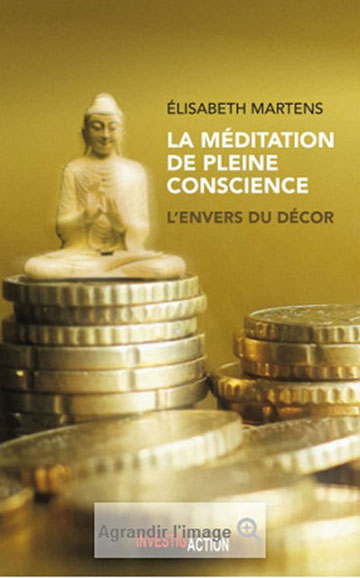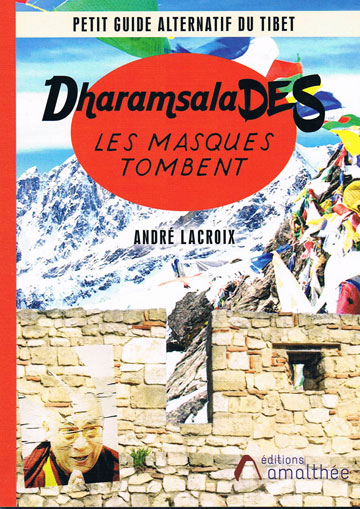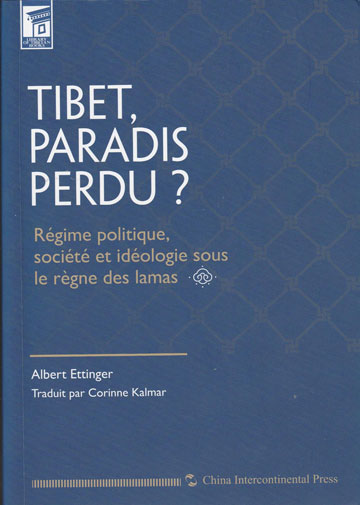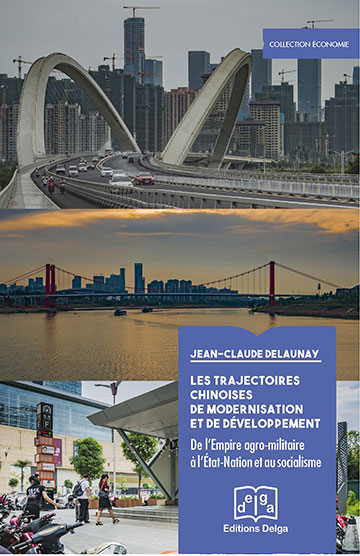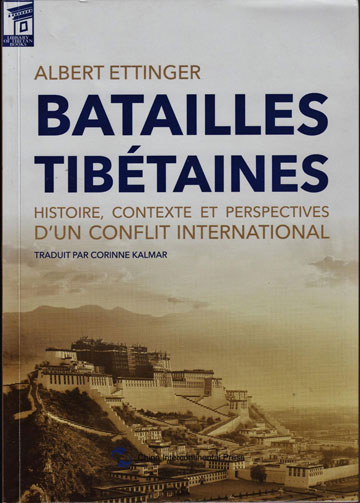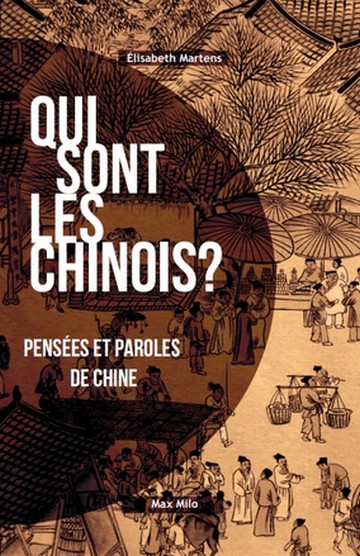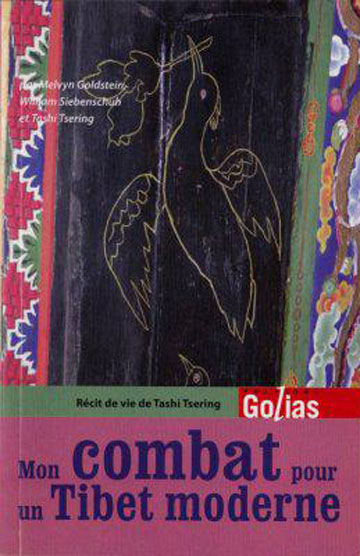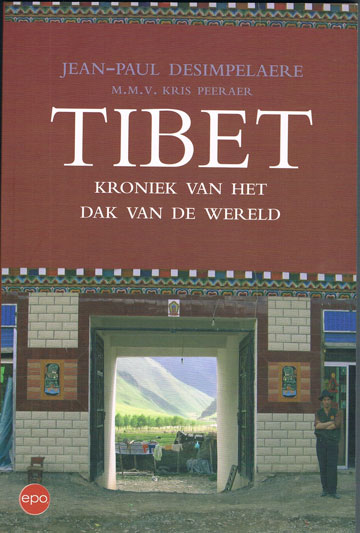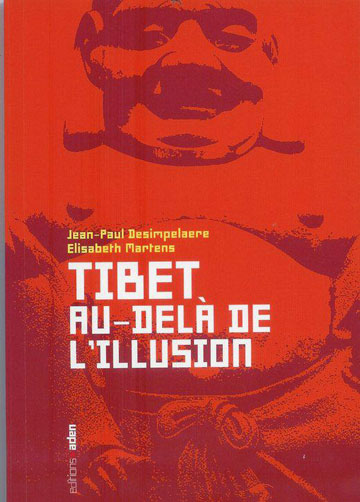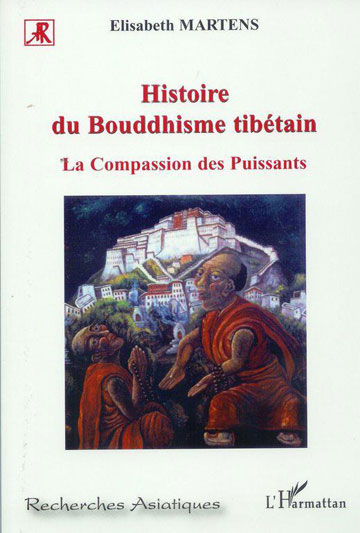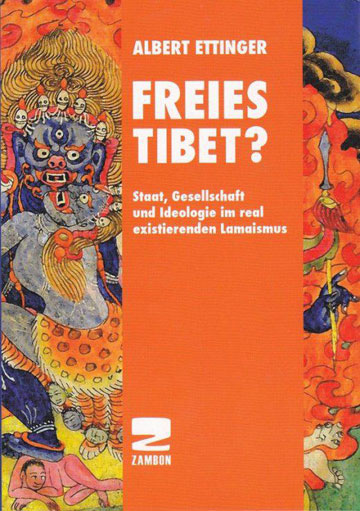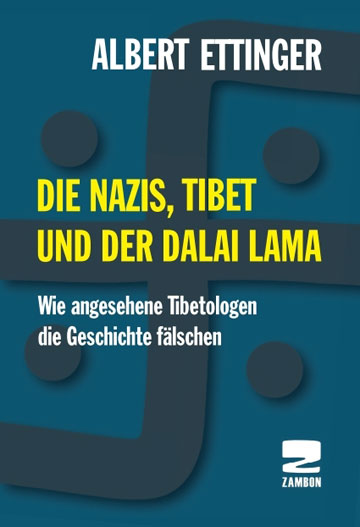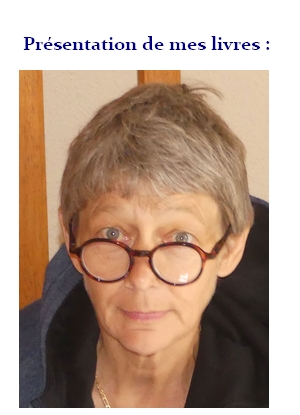La centrale de Medog fait couler beaucoup d'encre !
par Élisabeth Martens, le 17 septembre 2025
La centrale hydroélectrique de Medog est un immense projet hydroélectrique en cours de développement sur le fleuve Yarlung Tsangpo, au Tibet, en Chine. Cette centrale, dont la construction a commencé en juillet 2025, est prévue pour produire 300 milliards de kilowattheures par an, devenant ainsi la plus grande du monde. Chez nous, elle soulève des inquiétudes écologiques et géopolitiques considérables.

L'énergie hydraulique du Tibet (Xizang)
Le Tibet-Xizang est la province chinoise la plus verte de Chine, 90% de sa consommation énergétique vient du renouvelable. L'énergie hydraulique constitue un réservoir d'énergie verte majeur, à côté du solaire et de l'éolien qui sont aussi largement exploités.
L'hydraulique est l'énergie renouvelable qui fut la première exploitée, c'est pourquoi la région autonome du Tibet compte une quantité innombrable de petits barrages dont on ne parle jamais mais qui sont essentiels pour les besoins locaux.
Les constructions hydrauliques plus imposantes sont récentes. Le plus grand barrage hydroélectrique en service actuellement au Tibet est celui de Zangmu. Il a été mis en circulation en 2015, avec une capacité de 510MW. Puis il y celui de Gyaca mis en service en 2021 avec 360MW de capacité énergétique. Celui de Dagu est opérationnel depuis 2022 avec une capacité de 660MW. Et celui de Jiexu est en construction et devrait atteindre les 560MW de capacité.
Ces barrages sont de capacité moyenne comparativement aux 198 barrages hydroélectriques disposant chacun d’une capacité d'au moins 1000MW et qui sont dispersés dans 12 pays dans le monde en commençant par la Chine qui en compte 60, puis le Brésil, le Canada, la Russie, les États-Unis, l'Inde, la Norvège, le Venezuela, le japon, la Suède, la Turquie et la France.
Un autre point de comparaison est la capacité du plus grand barrage du monde, celui des Trois Gorges qui génère au total 22.500MW, soit 22,5GW. Ce dernier fournit environ 10 % de l'électricité hydroélectrique chinoise et joue un rôle clé dans le réseau énergétique national. La centrale hydroélectrique de Medog qui, rappelons-le, ne comprend pas de barrage mais des retenues d'eau en cascades (ce qui diminue les dégâts écologiques et évite le déplacement de populations, fournirait trois fois plus que celui des Trois gorges puisqu'il atteindrait 60GW.
Le Groupe d'information sur le Tibet au Parlement européen
Le 3 décembre 2024, le Groupe d’information internationale sur le Tibet qui s'est constitué au sein du Parlement européen s’est penché sur la gestion de l’eau du plateau tibétain. Le projet de la centrale de Medog a été au centre des discussions. Trois chercheuses tibétaines sont intervenues lors de ce colloque : Palmo Tenzin, chercheuse et chargée de plaidoyer pour l’International Campaign for Tibet (ICT) en Allemagne, Dechen Palmo, chercheuse en environnement au Tibet Policy Institute en Inde et siège du gouvernement tibétain en exil, et Tenzin Choekyi, chercheuse pour l’ONG Tibet Watch.
Toutes les trois sont issues de la communauté tibétaine en exil. Dès lors, comment peuvent-elles représenter les 6 millions de Tibétains de Chine ? Cela n'est pas cohérent et, comme de bien entendu, d'entrée de jeu, elles ont haussé le ton et affirmé : « Le Tibet, bien que souvent considéré comme une province chinoise, est en réalité un pays annexé par la Chine en 1950. Depuis cette date, la Chine poursuit une politique à grande échelle d’effacement de l’identité tibétaine par de nombreux biais : destructions de monastères, envoi des enfants tibétains en pensionnat pour apprendre le mandarin, accaparement de leurs ressources naturelles, etc. »
Dès qu'ils ont entendu parler de la méga centrale hydroélectrique de Medog, les médias mainstream, fidèles reflets de nos dirigeants du G7, se sont précipités, comme des hyènes sur une charogne : il y avait de la matière à ronger. Déjà, on a écrit : « Les ONG locales et internationales expriment leurs préoccupations quant à un éventuel déplacement forcé de ces populations, qui pourrait aggraver les tensions ethniques et culturelles dans la région ». Qui parle des tensions ethniques sinon ceux qui espèrent diviser les peuples pour les contrôler ?
Bref, comme toujours quand il s'agit du Tibet-Xizang, ce sont les émotions qui priment. Et si le bon sens venait justement de ce grand pays communiste qui ne cède pas au climat ambiant de nationalisme, d'ethnocentrisme, de séparatisme qui mine notre « monde libre » en dressant les peuples les uns contre les autres ("divide et impera": ça tient toujours !) ? Et si le bon sens nous dictait de suivre son exemple quand il s'efforce de garder unis des peuples de culture et de langue différentes ?
Comme quoi n'importe quel sujet qui touche au Tibet sert de prétexte pour raviver les sempiternelles fadaises d'un Tibet envahi par la Chine" (mais envahit-on son propre pays?), d'un Tibet soumis à la destruction de sa langue, de sa culture, de sa religion, etc...
Réalités tibétaines
Pour avoir voyagé au Tibet pendant plus de trente ans, d'est en ouest et du nord au sud, je témoigne haut et fort que ces affirmations sont mensongères. Les monastères sont rénovés et les moines tibétains se multiplient à une vitesse qui pose question ; les enfants sont envoyés au pensionnat : bien évidemment, puisque les distances sont énormes au Tibet ; on leur enseigne le chinois, certes, puisque c'est la langue nationale, mais on leur enseigne aussi le tibétain, que, d'ailleurs, on entend parler partout (il faudrait plutôt dire: « les tibétains » tant il y a de dialectes différents) ; les ressources naturelles sont exploitées : quel est le pays qui n'exploite pas ses ressources naturelles ?
J'ajoute ici que le Tibet n'a pas été annexé à la Chine en 1950 puisqu'il l'était déjà depuis le 13ème siècle ; cela s'est passé sous la dynastie mongole des Yuan qui régnait sur quasi toute l’Eurasie. Puis le Tibet est devenu une province chinoise sous la dynastie des Qing au 18ème siècle.
La communauté tibétaine en exil, dont font partie les trois chercheuses du Groupe d'information sur le Tibet au Parlement européen, est composée essentiellement de l'élite cléricale et des descendants de l'ancienne noblesse tibétaine. Elle représente 2% des populations tibétaines, les 2% qui ont opprimé le peuple tibétain pendant plus d'un millénaire.
Les Tibétains en exil n'ont cure de ces faits historiques, de la même manière qu'ils n'ont cure de la réalité des Tibétains d'aujourd'hui. Ils sont aveuglés par la volonté de reprendre le pouvoir sur la région tibétaine et, surtout, ils sont poussés dans le dos par les ambitions occidentales de diviser la Chine. Depuis le début des années 1950, ils ont été soutenus par les États-Unis, d'abord via la CIA, puis via le NED.
Avec de telles œillères, le discours des trois chercheuses tibétaines à propos de la centrale hydroélectrique de Medog est d'emblée biaisé. Comment la communauté tibétaine en exil pourrait-elle représenter au Parlement européen les 6 millions de Tibétains vivant en Chine ? Que sait-elle de leurs avancées, de leur développement, de leurs victoires, de leurs revendications ?