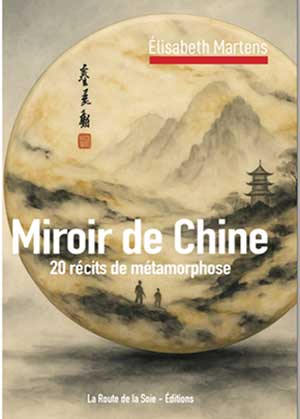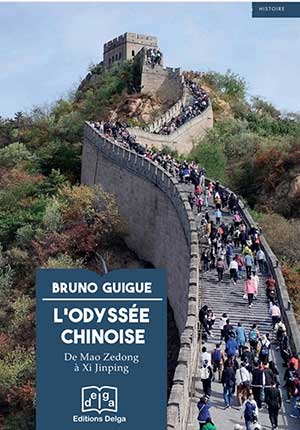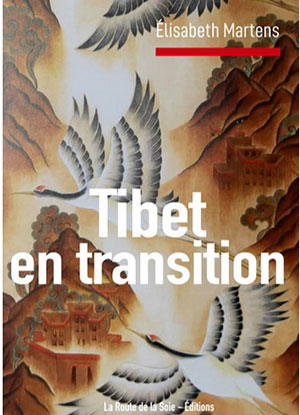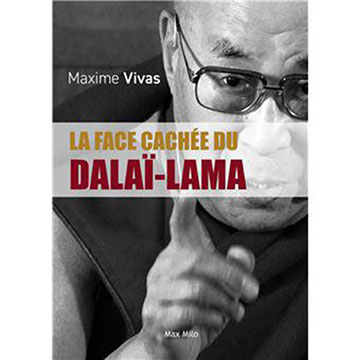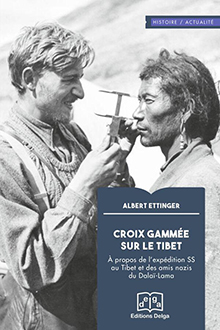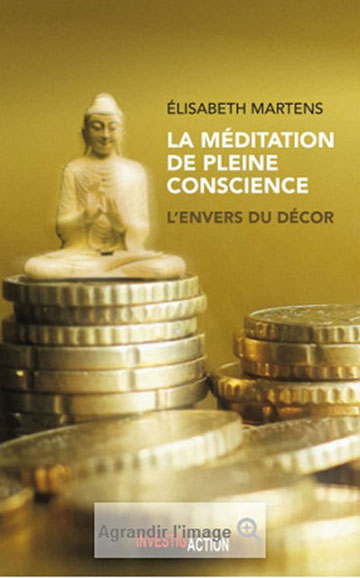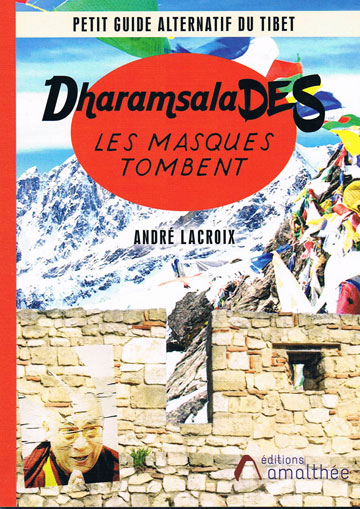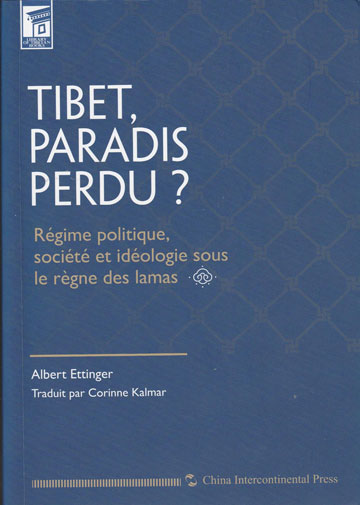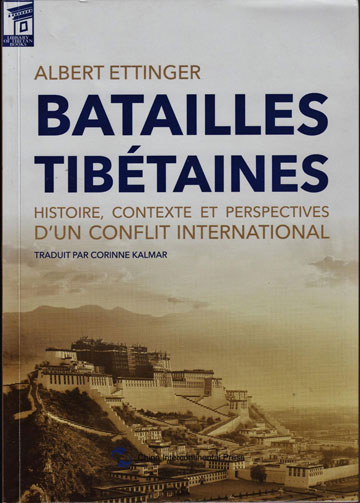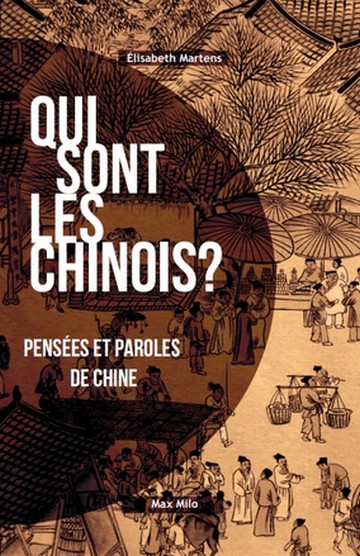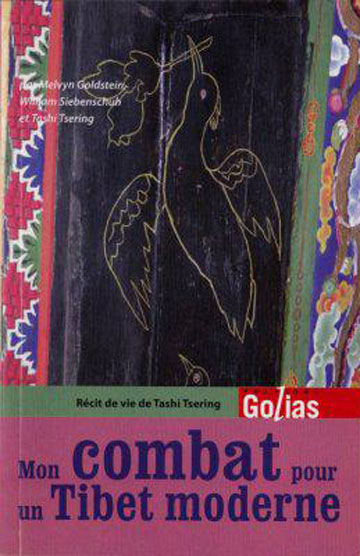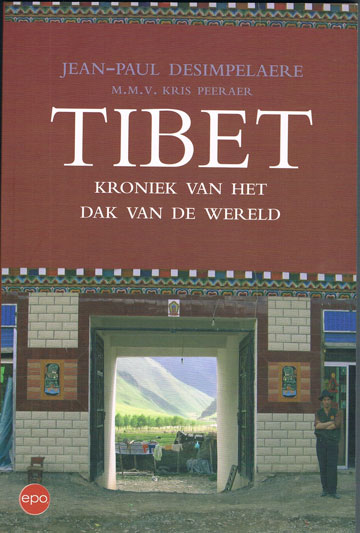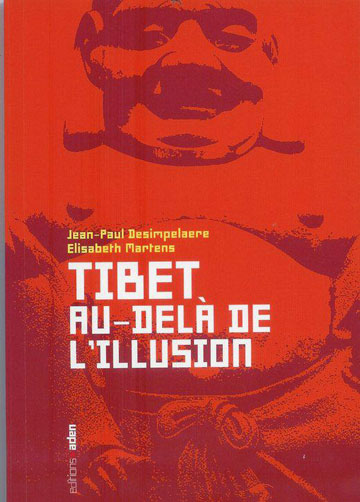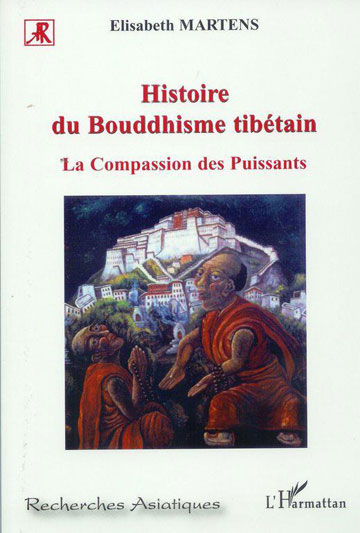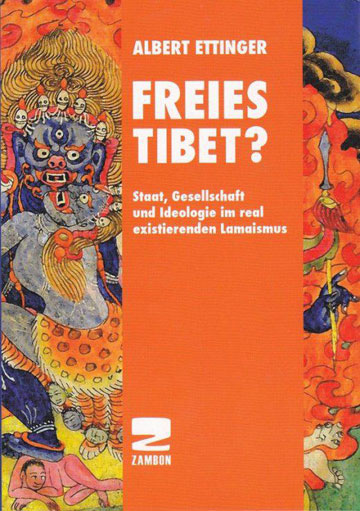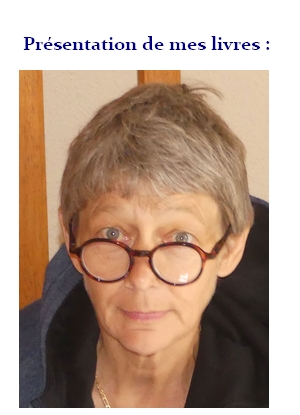Du Tao au dharma
par Elisabeth Martens, le 11 mai 2009
Pour expliquer mon point de vue à propos de l’avenir du bouddhisme en Chine, j’aimerais commencer par faire un retour historique et dessiner rapidement l’histoire du bouddhisme en Chine. Je voudrais aussi expliquer quels sont les éléments qui ont permis au bouddhisme de prendre son envol en Chine, alors que le milieu intellectuel n’y était pas préparé.
Le bouddhisme a été introduit en Chine au début de notre ère grâce à des marchands indiens et perses, par les Routes de la Soie. A l’instar de ce qui s’est passé dans d’autres pays où le bouddhisme a pris pied, il ne s’est pas développé immédiatement et est resté végéter pendant quelques siècles, comme en latence.
Au début de notre ère, l’Empire du Milieu ne présentait pas le paysage adéquat pour recevoir un enseignement tel que le dharma ; la Chine connaissait un moment de gloire, tant au niveau économique, que politique, que social. La dynastie des Han (206 AC- 220 PC) a toujours été considérée comme la « dynastie modèle » par les dynasties suivantes.
De plus, depuis la haute antiquité, les philosophes chinois avaient déjà emprunté bien des chemins de traverses, passant par les traumatismes des démiurges, des séismes mythologiques, le doute quant aux origines, des hésitations face aux sources jaunes (là où se rassemblent les défunts), le glaive des moralistes, l’éthique politique, les interrogations quant à la réalité de la réalité, une vaste remise en question du langage, etc. Bien que, comme partout ailleurs, les dieux aient fait leur chemin à travers les dédales de l’inconscient chinois, la Chine antique (tout comme la Grèce d’ailleurs) s’est engagée vers un système de pensée matérialiste.
Ceci découle du fait qu’elle a développé sa pensée à partir de l’observation du monde ; dès lors, elle n’a pas succombé outre mesure aux mirages des idées (ce qui fut moins vrai en Grèce où le logos l’a emporté sur l’observation).
Arrivés vaille que vaille à l’illustre dynastie des Han, le temps était venu de mettre de l’ordre dans la multitude d’idées et le foisonnement des écoles philosophiques qui ont caractérisé la fin de l’antiquité. Les philosophes des Han classent, trient, jettent, rangent, systématisent.
En résulte une vision holiste de l’être humain ; celui-ci est intégré à l’univers qu’il habite au même titre que toutes les autres formes inertes et vivantes (les « wan wu », ou « dix mille choses » dont l’être humain). Les divers matériaux constituants cet ensemble de formes distinctes ont une source commune, le « Yuan Qi » ou « Qi originel », un « Qi brut » dans le sens où il n’est pas encore différencié. « Le Qi n’est pas une substance qui aurait une existence repérable, en dehors des formes qu’elle prend. (…)
On a ainsi, d’une part, l’énergie qui, sans leur être extérieure, est distincte des formes concrètes, en tant qu’elle en est la source, c’est-à-dire le potentiel indéfini et infini, et en tant qu’elle demeure lorsque ces formes concrètes disparaissent, et, d’autre part, les formes que prend cette énergie, qui ne sont rien d’autre qu’elle » [1] .
Les contours quelque peu évanescents du système de pensée holiste connu sous les Han n’en dessinent que mieux un cœur palpitant au rythme du Yin-Yang, contraction - dilatation, alternativement. Quelle meilleure illustration de la double possibilité de manifestation du Qi, une fois formel (Yin, contraction, vers une forme), une fois informel (Yang, dilatation, vers un non-forme). « Une fois Yin, une fois Yang, tel est le Dao », avait déjà commenté le « Livre des Mutations » (ou « YiJing ») au 3ème siècle AC.
Autrement dit, toute forme existant dans l’univers, inerte ou vivante, visible ou invisible, palpable ou impalpable, surgit de l’alternance de la double manifestation du Qi : matière -mouvement, attraction - répulsion, protons - électrons, plein - vide, etc., et tel est le « modèle de base » (ou « Dao »).
Cette pensée holiste, proposant le Dao comme modèle de base, le Qi comme matière première indifférenciée, et le Yin-Yang comme loi régissant le surgissement de toutes choses, est une pensée née de l’observation du vivant et, en-deça du vivant, de l’observation de l’agencement de la matière (le modèle « clef-serrure », par exemple, qui se retrouve partout dans la nature). Il s’agit d’une pensée où toutes les conditions de l’existence sont fonctionnelles, c’est-à-dire que toutes ont une fonction.
Bref, il s’agit d’une pensée qui ravit un évolutionniste, mais elle a la faiblesse de donner la possibilité au mystique de basculer vers une métaphysique de haut niveau. Le « Dao », souvent traduit chez nous par la « Voie » (avec un V majuscule !), peut en effet prêter à une interprétation transcendantale. Je veux dire par là qu’on pourrait rapidement succomber à la tentation de faire du Dao un Absolu régissant, à partir d’un extérieur à nos lois physiques, un monde physique : « dans le ‘Huainanzi’, un essai de synthèse de la spéculation ancienne dans une perspective taoïsante dont l’influence imprégnera toute la pensée Han, est exposée une conception du commencement du monde, non pas comme création, mais comme déploiement de la réalité en trois temps à partir du ‘souffle originel’ (ou Yuan Qi). » [2]
Cette possibilité de double lecture de la pensée holiste des Han, à un niveau « physique » (Dao comme modèle de l’évolution) et à un niveau « métaphysique » (Dao comme absolu à atteindre), caractérise la systématisation intellectuelle opérée sous les Han, époque à laquelle le bouddhisme s’est subrepticement introduit en Chine.
C’est ainsi que les Han, sans le savoir ni le vouloir, ont ouvert les portes à la grande remise en question qu’allait apporter le bouddhisme en Chine. Autrement dit, le dharma (ou enseignement du bouddha) a constitué un interlocuteur valable pour que la Chine fasse finalement le point avec la Transcendance, c’est-à-dire avec une entité, ou une force, ou tout autre chose de « surnaturel » et échappant aux lois de la physique.

En réalité, la Chine a été sensible au bouddhisme « à la longue ». Elle le fut d’abord en raison de circonstances historiques : après la dynastie des Han, l’Empire chinois a connu une longue période de division durant laquelle des populations étrangères se sont installées au nord, pendant que les lettrés chinois ont été se réfugier au sud.
Au nord, les dirigeants des petits royaumes se succédant ont cru bon de faire de la nouvelle religion (bouddhisme du Grand Véhicule), une religion d’Etat, histoire d’unifier des populations de culture et de langue diverses. A partir du 3ème siècle, et encore plus au 4ème siècle, le nord de la Chine a connu des conversions massives au bouddhisme. Il faut ajouter à cette composante historique, une composante morale : les modèles proposés par la Chine - Taoïsme, Confucianisme, Moïsme, Légisme, etc. - ne faisaient pas grand cas de la personne, préférant la collectivité à l’individu : l’être humain fait partie d’une « mécanique » bien huilée où chacun a une place « correcte » entre ciel et terre et a le devoir de s’y tenir.
Ceux qui s’efforçaient de développer une religion plus personnelle, ou qui souffraient d’inquiétude quant à leur destinée post-mortem, restaient insatisfaits. Les nouveaux missionnaires bouddhistes ont palliés à ce manque. L’attrait d’un nirvana, relativement facile à atteindre (du moins dans l’école bouddhiste chinoise du JingTu, la plus populaire) a accéléré les conversions, tant au nord qu’au sud, où elles se comptaient par dizaines de milliers tout au long du 4ème siècle, principalement parmi les paysans qui, rappelons-le, ont représenté plus de 90% de la population chinoise pendant l’histoire impériale (jusqu’au début du 20ème siècle). Ce sont eux qui ont constitué la « masse bouddhiste chinoise ».
Tandis qu’au sud du YangZi (Fleuve bleu), les intellectuels chinois réfléchissaient. Ils avaient cru que la Chine, déjà rodée à la pensée dialectique grâce à l’outil de réflexion proposé par le Yin-Yang, avait été débarrassée de la question de la Transcendance. Et voilà qu’une religion étrangère apparaissait sur leur territoire, remettant en question ce sujet épineux. La question allait d’ailleurs devenir sérieuse : les missionnaires bouddhistes se faisaient bien voir par la cour impériale et recevaient de celle-ci des appuis de plus en plus conséquents.
Il y avait de quoi réfléchir ! Après avoir sévèrement critiqué le célibat observé par ces moines d’une catégorie nouvelle – comment osaient-ils interrompre la chaîne ancestrale par une conduite aussi peu convenante ? - les lettrés chinois ont peut-être été séduits par le pari fait par le bouddha sur les potentialités de l’être humain. C’était somme toute un pari proche du modèle confucéen : pour se déployer, l’être humain compte sur lui-même et sur ses relations avec autrui, mais certainement pas sur un quelconque secours divin !
Si la Chine a connu de nombreux dieux et a divinisé tout autant d’êtres humains, c’était utilitaire : elle a le dieu de la porte de derrière et celui de la porte de devant, celui de la cave et du grenier, des casseroles et des tonneaux, etc. ; Mao Ze Dong est divinisé au même titre que Confucius ou que Shang Di. Par contre, la Chine n’a jamais développé une foi en un Dieu, qu’il soit créateur ou non, comme ce fut le cas dans la culture hindouiste et judéo-chrétienne. Aussi l’aspect athée de l’enseignement du bouddha s’accommodait bien à ce modèle chinois.
Toutefois les lettrés furent surpris par l’enseignement du bouddha…. à la longue, car il a fallu de longs siècles avant que les sutras et autres textes sacrés du bouddhisme soient traduits correctement en chinois. Ce n’est qu’à partir 6ème siècle que des traductions « valables » ont commencé à apparaître ; c’était une époque de « retour aux sources », durant laquelle des moines bouddhistes chinois partaient en pèlerinage sur les routes de la Chine vers l’Inde, en quête du véritable message du bouddha et à la recherche des authentiques livres sacrés du bouddhisme. Avant cette période, le bouddhisme avait été hâtivement assimilé au taoïsme en raison des similitudes entre les pratiques bouddhistes et taoïstes : exercices gymniques, respiratoires et méditatifs. Aussi les traducteurs de sutras ont pendant longtemps utilisé des termes taoïstes pour rendre des concepts typiquement bouddhistes. [3]
« Quand le Bouddha obtient la Boddhi, c’est-à-dire l’Illumination, on dit en qu’il a obtenu le ‘Dao’(…) Le Nirvana, l’existence inconditionnée, qui est le but du salut (bouddhiste) devient le ‘non-agir’ ou ‘wuwei’, qui est précisément le mode d’activité propre aux plus hauts des Immortels (taoïstes). Il ne serait pas difficile de vous citer un grand nombre d’expressions ainsi empruntées au Taoïsme par les premiers traducteurs » . Imaginez la confusion… et la surprise des lettrés lorsque, enfin, ils furent en présence d’une pensée qui ne leur était pas tellement étrangère puisqu’elle développait de nombreux aspects matérialistes. Mais elle n’en restait pas moins une religion pour laquelle le seul salut possible était de l’ordre du surnaturel ou du méta - physique.
Après cette période de confusion, puis de recherche d’authenticité, et ce jusqu’au 9ème siècle, le nirvana bouddhiste a été sujet à maintes discussions, véhémentes et trépidantes, entre lettrés et maîtres bouddhistes. Cela s’est surtout passé durant l’Âge d’Or de la Chine, la grande dynastie des Tang (618-907), qui correspond aussi à la période de gloire du bouddhisme chinois, une période de « sinisation du bouddhisme ».
A cette époque, l’institution bouddhiste avait pris une telle ampleur qu’elle était devenue un « Etat dans l’Etat », et menaçait même de faire vaciller l’économie chinoise. Cela fit jaser de plus en plus de lettrés qui finalement obtinrent gain de cause. Au 9ème siècle, l’Empereur publia un édit d’interdiction de pratiquer toutes religions étrangères sur territoire chinois, ce qui visait essentiellement le bouddhisme. Depuis lors, le bouddhisme « vivote » en Chine, se partageant entre trois écoles principales : le JingTu ou Ecole de la Terre Pure, la plus populaire, le Chan, plus austère et mieux connu sous son appellation japonaise « zen », et le MiZong ou Ecole Esotérique qui n’est autre que le bouddhisme tibétain. Il est plus correct de faire une étude séparée du MiZong, car cette école n’est pas issue de la sinisation du bouddhisme comme c’est le cas pour les autres.
En effet, le bouddhisme tibétain s’est formé vers le 10ème siècle grâce à la rencontre du bouddhisme tantrique indien et du Bön, religion qui existait au Tibet avant que ne s’y implante le bouddhisme . [4]
De plus, le bouddhisme tibétain n’a acquis une certaine influence sur le bouddhisme chinois qu’à partir de son adoption par les Mongols, au 13ème siècle. Il a donc une histoire particulière, c’est pourquoi je reviendrai séparément sur la question de l’avenir du bouddhisme au Tibet.
Après l’édit impérial interdisant la pratique des religions étrangères et la sévère répression des bouddhistes qui sévit à la fin des Tang, le bouddhisme battit de l’aile. S’ensuivit une période de remise en question quant à ce que le bouddhisme avait réellement apporté à la Chine, à laquelle s’ajoutait un désir de retour aux valeurs de l’Antiquité. Ce souffle de renouveau où le modèle confucéen resurgissait dans le paysage intellectuel chinois, a caractérisé la dynastie des Song (960-1279), période que l’on compare souvent à la Renaissance européenne. Les lettrés ressortent leurs vieux Classiques : YiJing, SuJing, ShiJing, et autres « Jing » (ou Classiques de l’Antiquité) vont inspirer plusieurs penseurs des Song qui critiqueront ouvertement le bouddhisme. Zhang Zai écrit au 11ème siècle : « dans ses propos sur la nature humaine, il apparaît que le bouddha n’a pas compris les mutations. Or, ce n’est qu’après avoir compris les mutations qu’il devient possible d’aller jusqu’au fond de la nature humaine » . [5]
Ou encore, un siècle plus tard, Zhang Shi écrit : « Quand le bouddhisme parle d’absence de désirs, il s’agit pour lui de s’attaquer à la racine et d’arracher l’arbre, de détruire les normes sociales. Il s’agit pour lui d’engloutir les principes qui fondent la réalité du monde dans le gouffre de la vacuité et de l’irréalité » . [6] Les penseurs des Song constituent une sorte de point de « non-retour » de la pensée chinoise : elle se dirige de manière lentement, mais de plus en plus affirmée et affinée, vers un matérialisme réfléchi de manière dialectique grâce à l’outil du yin-yang. Les penseurs chinois qui ont succédé à ceux des Song n’ont fait que confirmer cette tendance (c’est pourquoi ils n’intéressent que peu les occidentaux, quel dommage !).
Zhang Zai se prend-il pour un professeur de biologie qui réprimande un mauvais élève quand il dit : « le bouddha n’a pas compris les mutations » ?... et Zhang Shi d’ajouter que le bouddha n’a pas compris les mutations parce qu’il « fonde la réalité du monde dans l’irréalité ». D’après eux, le bouddha ne part pas de l’observation de la réalité, ce qui l’amène à isoler une réalité de toutes les autres : celle de la souffrance. Il se focalise sur cette seule réalité, la met en exergue et, du coup, l’isole de son contexte ; et parce qu’il veut à tous prix l’éliminer, il tombe dans le gouffre de l’irréalité.
Autrement dit, le bouddha invente un nouvel idéalisme, bien construit, certes, mais qui ne correspond ni aux normes sociales, ni aux contingences de ce monde, parce qu’il vogue dans l’irréalité. Pour les penseurs chinois des Song et leurs successeurs, le bouddha a une vision erronée de la réalité des choses, parce que pour lui, la seule existence qui vaut la peine d’être expérimentée est celle qui est totalement inconditionnelle, celle qui ne répond à aucune contingence, celle qui échappe radicalement à toutes les lois physiques et à toutes les limites temporelles. D’après le bouddha, c’est le seul moyen d’existence qui échappe radicalement à la souffrance.
En-dehors de cette existence « nirvanique », rien n’a d’existence absolue, aucune forme d’existence ne peut être dite « réelle », d’où le « vide » bouddhique, qui est un vide de réalité, ou un vide de sens.
A cela, la Chine répond qu’en effet, rien n’a d’existence « en soi » : toutes les choses sont reliées les unes aux autres par le seul fait qu’elles relèvent toutes d’une source unique, le Qi. L’interconnexion entre toutes les choses, visibles et invisibles (puisque nous savons maintenant que la matière nucléaire ne constitue qu’à peine 5% de ce que nous connaissons de l’univers), est une des caractéristiques de l’univers. Par ailleurs, toutes les choses sont portées à l’existence formelle (sous forme de matière nucléaire) de manière passagère : « Tout dans l’univers est constitué par le Qi. Les hommes et toutes les choses ne sont formés en réalité que d’une seule et même substance matérielle (…)
Toute naissance est une condensation de la matière et toute mort est une dispersion de la matière. La naissance n’est pas un gain, la mort n’est pas une perte (…) Condensée, la matière devient un être, raréfiée, elle est le substrat des mutations », écrit Zhang Zai . [7] Lorsque les penseurs chinois parlent du « vide », il ne s’agit pas pour eux du vide d’un de réalité ou de sens, mais d’un vide en tant que porteur des potentialités de renouveau, en tant que trame ou toile de fond de laquelle des réalités formelles sont susceptibles de surgir.
Les penseurs chinois partagent donc l’idée de l’impermanence, ainsi que celle de l’interconnexion, formulées par le bouddha, mais là où ils reculent, c’est lorsque le bouddha prétend que la seule Réalité et la seule Vérité est celle du Nirvana. Pour la Chine, rien n’a d’existence absolue, rien n’a un « en-soi », pas plus le nirvana qu’autre chose ; le nirvana bouddhiste reste de l’ordre de l’idée, il ne correspond à la réalité du monde. Comment le bouddha en est-il arrivé à une telle erreur de parcours ? Il aurait négligé d’observer les mutations et l’alternance des cycles, prétendent les lettrés. Pour une pensée matérialiste, comme celle amorcée durant l’Antiquité et se re-certifiant à partir des Song, toutes les conditions de l’existence sont fonctionnelles, c’est-à-dire que toutes ont une fonction. La souffrance n’échappe pas à cette observation.
La Chine ne considère pas la souffrance comme un mal duquel l’être humain doit absolument se débarrasser.
D’ailleurs, qu’est-ce que le mal ?... existe-t-il « en soi » ? Comme toute autre chose, il est relatif. La souffrance, elle aussi, est relative ; elle est relative à un autre état, tout aussi transitoire que la souffrance, un état où l’être humain se sent bienheureux, ou chanceux, ou simplement en bonne santé. Souffrance et bien-être sont deux états passagers qui, comme le cœur palpitant, alternent entre allées et venues ; pour qu’il y ait dilatation, il faut qu’il y ait contraction, pour qu’il y ait joie ressentie, il faut qu’il y ait souffrance ressentie… et inversement.
La souffrance n’existe pas « en soi », comme le mal n’existe pas « en soi », ni la joie, ni le plaisir. Dans une telle pensée « bio-organique », il n’y a pas de place pour un Absolu, qu’on le nomme « Nirvana », ou « Dieu », ou « Brahmâ », ou autrement. Qui penserait cet En-dehors du monde physique, puisque rien ne se pense en-dehors de lui ?... et quelle serait sa fonction ? Cet Unique, cet Absolu, n’est-il pas pensé dès lors que l’être humain se sent dé-noyauté, dés-unifié, dis-loqué, di-visé, dia-bolisé, etc. ?
L’être souffrant et schizophrène donne alors comme fonction au dieu qu’il a créé de le réunifier, de lui redonner sens, direction, unité, entité. Telle est la fonction des religions monothéistes.
L’enseignement du bouddha, parce que matérialiste à plusieurs points de vue (athée, pari sur le potentiel humain, impermanence, interconnexion, etc.), n’est pas tombé en terre complètement stérile en Chine. Les lettrés ont eu de quoi discuter pendant quelques siècles. Mais ce qui a le plus prêté à discussions était le but ultime du dharma : le Nirvana. Grâce à lui et à son caractère d’Absolu, la Chine s’est vue obligée de trancher dans son hésitation par rapport à la Transcendance (ou au surnaturel, au métaphysique).
Avant l’arrivée du bouddhisme en Chine, la pensée holiste des Han n’était pas clairement matérialiste ; elle restait teintée de surnaturel. C’est pourquoi le Nirvana bouddhiste a usé beaucoup de pinceaux, d’encre et de papier et a donné l’occasion à la pensée chinoise de se tourner résolument vers un matérialisme choisi et assumé.
A cet important tournant dans l’histoire de la pensée chinoise, qui eut lieu suite et grâce à l’aventure bouddhique, on peut ajouter que le bouddhisme a aussi apporté à une Chine austère, presque sévère, un petit vent de fraîcheur et de douceur. Grâce au dharma, la Chine a pu parler de l’ego, chose impensable, presque indécente, dans une société essentiellement tournée vers le bien-être collectif : famille, village, place dans la « mécanique sociétale ». Comment penser l’ego dans un tel carcan ? Est-il pensé, ou même ressenti ? Pourtant, comme tous les êtres humains, les chinois aussi ont besoin de reconnaissance, ils dépendent d’un affect et du regard de l’autre. Dans le concept du « ren » confucéen (? : un être humain s’élève grâce à sa relation à l’autre), le regard extérieur est présent. Et même plus : « je ne deviens moi-même qu’à travers le regard de l’autre »… il s’agit bien de l’ego !
Mais l’ego, est-il ressenti en Chine comme source de souffrances ? A nouveau, la Chine n’isole pas la souffrance de son contexte vital. Quand on se sent limité, compressé, on est poussé à s’étendre et à se déployer ; et quand on est arrivé à une expansion maximale, on n’a plus qu’a se racrapoter. Expansion – compression : c’est ainsi qu’avance un ver de terre ou que se nourrit l’anémone de mer. A l’échelle humaine, « expansion » est notre besoin d’ouverture, de « reliance », d’union avec l’environnement humain et le monde vivant, avec la matière organique et cosmique. Le mouvement de compression signe un retour vers soi, un repli nécessaire pour identifier et faire surgir les potentiels de notre ego. Expansion est suivie de compression, compression est suivie d’expansion, il s’agit d’un mouvement alternant, dont les deux pôles s’interpellent, et l’écho de l’un amène le germe de l’autre à se manifester. L’ego et son désir de reconnaissance y ont leur place, le social et son besoin de repli vers soi tout autant.
De même : connaît-on aujourd’hui la souffrance ?... demain réapparaîtront des jours meilleurs ! Cela a-t-il amené les chinois à se laisser aller au fatalisme ? Non, car il est évident que certaines conditions de vie de l’être humain peuvent être améliorées. Inventons une manivelle pour alléger le travail de puiser l’eau, puis un treuil pour tirer les charges jusqu’au sommet, des charrues pour faciliter les labours, construisons des ponts pour ne pas faire des détours insensés, des harnais à collier pour ne pas fatiguer inutilement les chevaux, un parapluie pour ne pas rentrer tout mouillé, etc. Des milliers de techniques ont été inventées pour faciliter la vie quotidienne… évidemment, on n’atteint pas le Nirvana en parapluie !
Bien que… la souffrance de l’être humain peut être adoucie par un petit air de flûte, ou par la main prise à l’adversaire au jeu de go, ou par la fluidité du pinceau du calligraphe… autant de méthodes pour se refondre dans le paysage environnant, faire resurgir le sentiment d’appartenance au monde, concrétiser notre alliance à la matière.
Le Bouddha, lui aussi, parlait de ce sentiment d’appartenance au monde matériel, mais il en parlait comme le remède infaillible pour nous débarrasser de notre sentiment d’ego, principale source de souffrances. Il exhortait ses disciples à s’expérimenter comme constitués de divers matériaux que chacun partage avec tous et avec l’univers. Il prétendait que de cette manière, l’être humain ne ressent plus son ego comme un « en-soi » pesant, puisqu’il se sent faire partie du monde, de l’environnement, des matériaux environnants. Mais à nouveau, s’il stimulait ses proches à expérimenter leur appartenance au monde matériel, c’était dans l’unique but de se débarrasser définitivement de la souffrance engendrée par le sentiment de l’ego.
Se ressentir comme une construction et un assemblage de matériaux que l’on partage avec les autres, dissout le sentiment de l’ego, et par là dissout la souffrance, car l’ego est alors ressenti comme aussi impermanent que le reste, prétend le bouddha. En effet, le sentiment d’ego s’évanouit devant la danse insatiable de l’énergie (comprise ici comme « matière en mouvement » ou « mouvement de la matière »). Tout à coup, je me souviens que les cellules proprioceptives composant mes organes des sens sont issues des propriocepteurs de l’amibe et que, comme l’amibe, je me dirige grâce à des signaux chimiques émanant de mon environnement. Avec délice, j’expérimente que c’est la couleur, la rondeur et l’odeur de la pomme qui m’attirent inexorablement vers elle, et qui m’amènent à y mordre à pleines dents. Avec une excitation à peine dissimulée, je hume l’odeur du mâle travaillant et suant.
Pourtant, il n’y a là rien de nouveau ; mes cousins chimpanzés ne l’ont d’ailleurs pas oublié… Toutefois, ces doux rappels à l’évidence que j’appartiens à la matière minérale et animale, que je suis constituée de poussières d’étoiles et de matières intersidérales, que comme eux je fais partie de l’impermanence, ne résonnent pas en moi comme un remède infaillible à une douleur existentielle, un remède sensé m’emmener au-delà des impermanences. Au contraire, c’est avec un plaisir chaque fois intense et renouvelé que je goûte aux passages des saisons, aux variations des couleurs, des climats, des odeurs… « Impermanence ! » s’écrie le maître bouddhiste, et il tourne son visage illuminé vers l’ouest salvateur, symbole de pérennité.
« Bien sûr, impermanence », répond le chinois, « et puis quoi ? y a-t-il quoi que ce soit qui ne le soit ? Tout est impermanent, se transformant, changeant. Il est bien illusoire de prétendre à une quelconque pérennité des choses, des êtres ou des relations. Y a–t-il à rire ou pleurer d’un tel constat ? Apprenons les passages, car c’est lorsqu’un être humain reste coincé, immobile, figé, tendu vers un but unique, que son aisance diminue ; sa longévité dépend de son habilité à surfer sur les multiples remous de l’existence. »
Certes, le bouddha n’a pas compris les mutations !
En guise de conclusion, je vous dirai rapidement mon point de vue quant à l’avenir du bouddhisme en Chine. Pour ce faire je reprends l’histoire où je l’avais laissée, à la dynastie des Song. Les penseurs des Song ont amorcé un tournant important dans l’histoire de la pensée chinoise : à cette époque, le matérialisme s’est choisi de plus en plus consciemment, pour ne pas dire consciencieusement. Suite aux Song, la Chine impériale a connu deux dynasties étrangères, les Mongols ou dynastie des Yuan (1264-1368), et les Mandchous ou dynastie des Qing (1644-1912).
Bien que toutes les deux se soient intimement liées au bouddhisme tibétain, ni l’une ni l’autre n’ont réussi à réintroduire en Chine une discussion de fond à propos de l’enseignement bouddhiste. Aussi, après la grande aventure bouddhique, qui s’est soudainement effondrée avec la dynastie des Tang au 9ème siècle, le feu du bouddhisme n’a pas réussi à se rallumer. Le matérialisme, né durant l’antiquité chinoise, a résolument pris le pas sur les autres idéologies. Non pas que le bouddhisme ait disparu des terres chinoises, pas plus que le taoïsme religieux, l’islam et les autres religions, mais il n’a plus dominé le paysage intellectuel comme c’était le cas précédemment.
De plus, depuis la dynastie des Han, au début de notre ère, la Bureaucratie céleste (système de gouvernement impérial) a mis en place un Bureau de contrôle des institutions religieuses, afin que celles-ci n’exercent pas un pouvoir rival. Ce système de contrôle a fonctionné tant bien que mal, par exemple, durant les Tang, l’institution bouddhique a été violemment refreinée parce que le Bureau a manqué de vigilance au moment adéquat. D’autres exemples sont donnés par les révoltes paysannes qui caractérisent la décadence des dynasties chinoises et leurs abus de pouvoir sur les populations rurales. La plupart de ces révoltes ont été menées par des maîtres taoïstes qui ont organisé des mouvements de masse échappant au système de contrôle. Bref, cette vigilance par rapport aux exactions des religions fonctionnait vaille que vaille.
La Chine moderne a hérité de cette coutume puisque actuellement, les institutions religieuses sont encore contrôlées par un bureau spécial. Leurs activités, tant rituelles qu’économiques, y sont répertoriées, ainsi que le nombre de temples construits et rénovés, le nombre de moines ou de religieux habitant dans les monastères, le calendrier des fêtes, etc. Le gouvernement chinois prétend que ce contrôle s’exerce pour estimer le budget à allouer à chacune d’elle, ce qui n’est pas faux, mais c’est assez incomplet !

Alors l’avenir du bouddhisme en Chine ?
Je pense qu’il n’a pas un avenir plus radieux que le « vivotage » qui le caractérise depuis la fin des Tang. Evidemment, on assiste en Chine à une résurgence du phénomène religieux, bouddhisme en tête de liste, qui répond au déclin philosophique et spirituel de l’après Révolution culturelle. Mais tenant compte de l’enracinement du matérialisme dans la culture chinoise, cette résurgence n’est pas un spectre menaçant, comme elle peut l’être en Amérique latine ou aux Etats-Unis, où le matérialisme n’a que peu d’ancrage.
Quand je parle de « l’enracinement du matérialisme en Chine », je pense que la très grande majorité des chinois sont peu conscients de cet héritage. Ils sont de « culture matérialiste », de la même manière que la majorité des occidentaux sont de « culture chrétienne », sans pour autant être croyant, ni même conscient de ce que leur apporte encore cet héritage chrétien.
Mais puisque la Chine est culturellement matérialiste, je pense que l’impact du renouveau religieux va rester relativement superficiel. Ne serait-il pas judicieux de la part du gouvernement chinois, pour contrer la résurgence du phénomène religieux, de diriger l’enseignement vers une conscientisation de l’héritage matérialiste ?... par exemple, en organisant des joutes oratoires (comme le font les moines bouddhistes !) pour stimuler les jeunes à argumenter leur positions philosophiques et s’affirmer dans leur héritage culturel matérialiste ?

Notes
(1) Isabelle Robinet, « Histoire du Taoïsme », p.17
(2) Anne Cheng, « Histoire de la pensée chinoise », p.282
(3) Henri Maspéro, « Le taoïsme et les religions chinoises », p.287 chinois
(4) voir l’article « Le bouddhisme tibétain, l’écrin protégeant les trois joyaux » sur www.tibetdoc.eu
(5) cité par Anne Cheng dans « Histoire de la pensée chinoise », p.426
(6) cité par Jacques Gernet dans « L’intelligence de la Chine », p.30
(7) cité par J-A.Lavier dans « Nei Tching Sou Wen », p.22