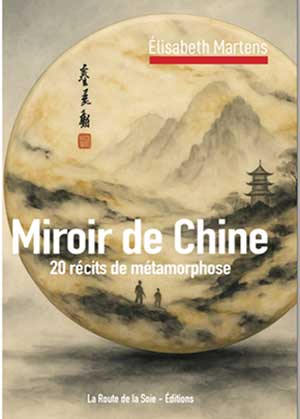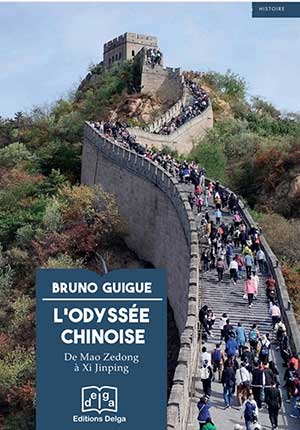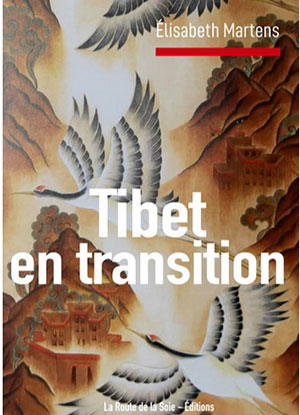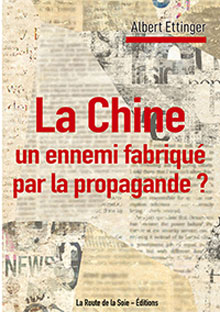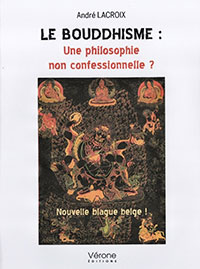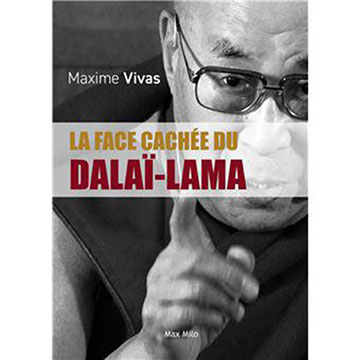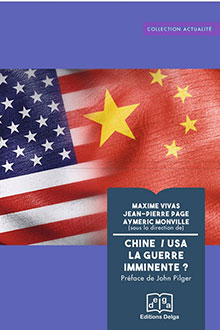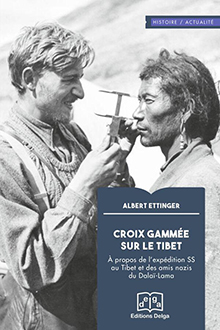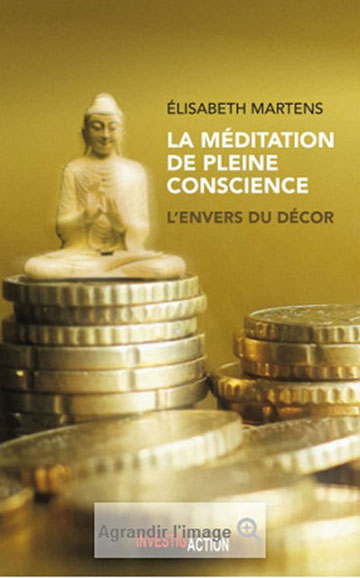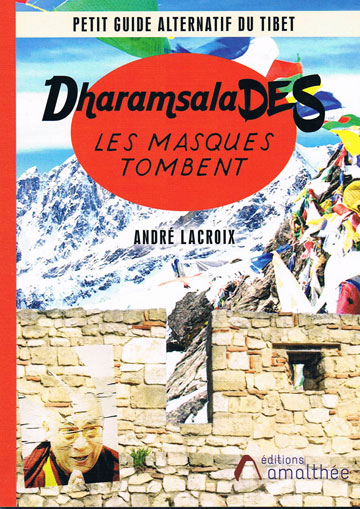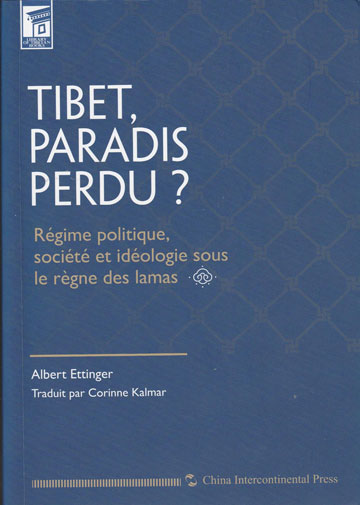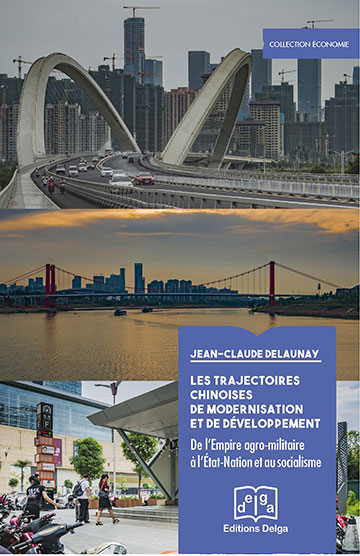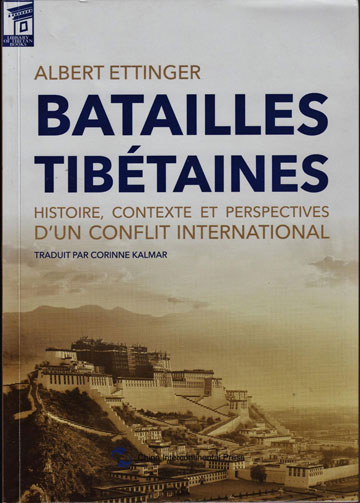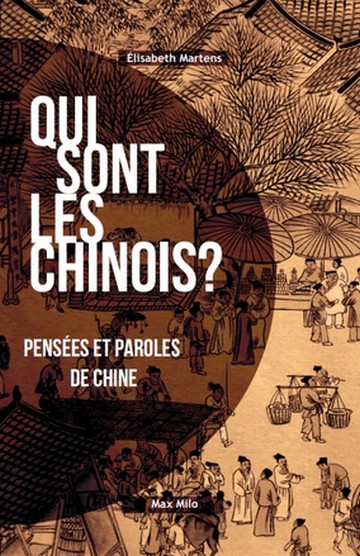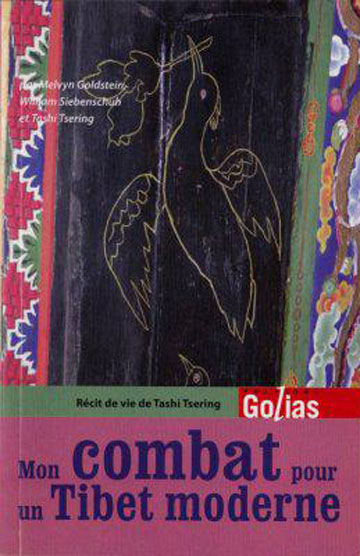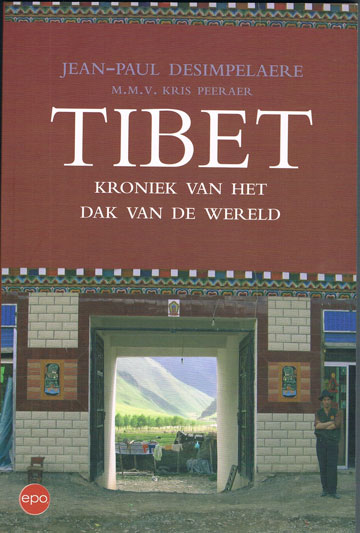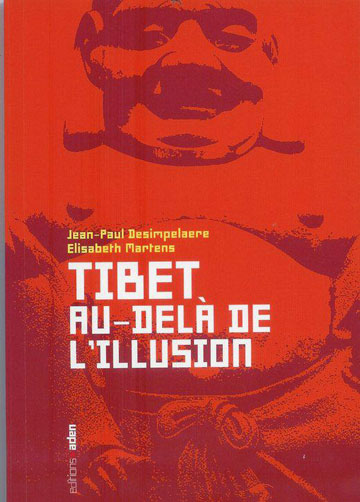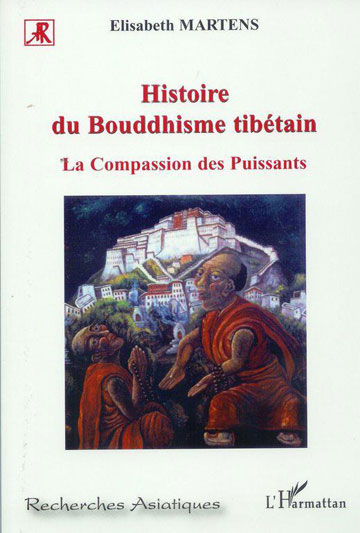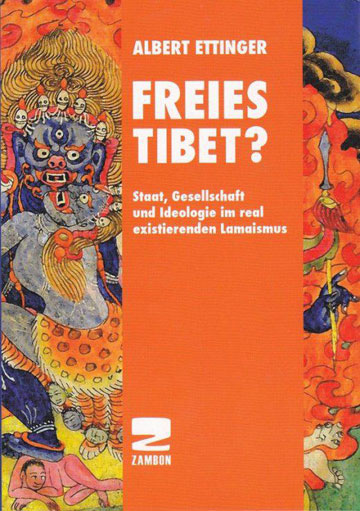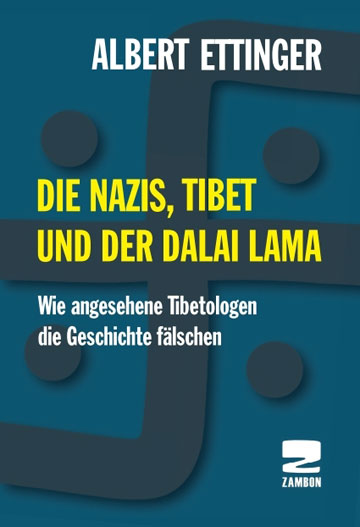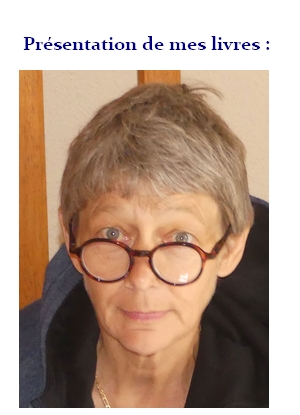La délicate question de la succession du dalaï-lama
par Elisabeth Martens, le 19 mars 2025
Le dalaï-lama publie un nouveau livre intitulé Une voix pour les sans-voix dans lequel il souhaite « offrir un cadre pour l'avenir du Tibet » après sa mort. Il y confirme ses discours précédents et sa volonté de voir le Tibet se séparer de la République populaire de Chine (RCP). Existe-t-il d'autres propositions pour sa succession ?

Dans son nouveau livre intitulé Une voix pour les sans-voix publié aux éditions HarperCollins sorti le 12 mars 2025, le dalaï-lama parle « d'une leçon claire de l'Histoire : si vous maintenez un peuple constamment mécontent, vous ne pouvez pas avoir de société solide. »
Certes, le dalaï-lama n'est plus retourné au Tibet, ni dans sa région natale au Qinghai, depuis son exil en 1959. Comment sait-il que les Tibétains ne sont pas contents de leur sort ? Il n'était pas là pour constater les énormes changements qui se sont produits en Région autonome du Tibet (RAT) et qui ont considérablement amélioré les conditions de vie des Tibétains. Les importants investissements chinois dans de nombreuses infrastructures expliquent ce développement continu. L'actuelle multiplication des énergies renouvelables a permis aux villages les plus reculés d'être fournis en électricité, la construction de routes nouvelles et de voies ferrées a favorisé les échanges avec l'intérieur du pays et l'Inde voisine. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont fait d'immenses progrès. Le dalaï-lama aurait-il oublié que l'espérance de vie était de 35 ans en 1959, sait-il qu'elle est actuellement de plus de 72 ans ? Se souvient-il qu'en 1959 le taux de mortalité infantile était d'au moins 430 décès pour 1000 naissances ! Alors qu'il est estimé aujourd'hui à 8 ou 10 pour 1000 naissances. En 1959, le taux d'analphabétisme était de 95%, il est aujourd’hui de 2 à 5%.
Bien sûr, il ne s'agit là que de chiffres (de Wikipédia !), mais ils démontrent a minima que le gouvernement chinois n'a jamais eu l'ambition de « coloniser le Tibet », comme prétendu chez nous. Une colonie se fait piller, alors qu'au Tibet
le PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA) par habitant est d'environ 12.000 à 15.000 dollars, le double de celui de la RD du Congo et le quart de celui de la Belgique.
« Du jeune homme de 19 ans négociant avec un Mao au sommet de sa puissance jusqu'à mes récentes tentatives de communication avec le président Xi Jinping, j'exprime dans ce livre la sincérité de nos efforts", écrit le dalaï-lama rappelant ses « discussions avec les dirigeants successifs de la République populaire de Chine au nom du Tibet et de son peuple. »
Quelles furent ses discussions avec les autorités chinoises?
Au milieu des années 1980, après deux décennies de lutte non aboutie pour séparer le Tibet de la RPC – une lutte soutenue par la CIA, ne l'oublions pas ! -, le dalaï-lama propose une « Voie du milieu », ou « autonomie poussée », en lieu et place d'une indépendance complète. Or, si on lit attentivement la « Charte des Tibétains en exil » rédigée en 1991 et encore d'actualité aujourd'hui, il est assez évident que sa « Voie du Milieu » n'est rien d'autre que l'indépendance. D'après ce document, le Tibet devrait être une « entité politique basée sur sa propre constitution ». N'est-ce pas la caractéristique même d'une nation indépendante ? De plus, l'« autonomie poussée » y est clairement définie : elle concerne le « Grand Tibet » que le dalaï-lama appelle le « Tibet historique », soit un quart du territoire de la Chine ; elle revendique un Tibet ethniquement pur, donc le départ des immigrés chinois han et hui, et des autres minorités habitant depuis des siècles dans les provinces limitrophes de la RAT ; elle revendique une constitution tibétaine basée sur le bouddhisme (n'est-ce pas ce qu'on appelle une théocratie ?), une démocratie pluripartite, la liberté du Marché, et le départ de l’armée chinoise. Bref une autonomie vraiment très très très poussée, et des « discussions » avec le PCC qui ressemblent furieusement à des attrape-nigauds.
Pour preuve de l'obstination du dalaï-lama à vouloir ratifier l'indépendance du Tibet en y incluant les régions du Qinghai, du Gansu, du Sichuan et du Yunnan où habitent des Tibétains, on peut relire le discours que le dalaï-lama a prononcé devant le Congrès américain il y a trente ans. Il y avançait un « Plan de paix en cinq points » pour régler la question tibétaine ; puis celui qu'il a fait quelques années plus tard à Strasbourg lorsqu'il a présenté un « Nouveau programme en 7 points ». Il y eut encore son discours à Oslo en 1989 lors de son attribution du prix Nobel de la Paix. Tous ces discours vont dans le même sens, celui d'une « autonomie poussée » qui n'est autre qu'une demande d'indépendance, comme il le fait depuis son départ de Lhassa en mars 1959. Il n'a pas reculé d'un iota dans ses revendications, il a juste changé le vocabulaire.
Il affirme avec beaucoup de conviction que « son successeur naîtra en dehors de la Chine, dans le monde libre ». À quel « monde libre » fait-il allusion sinon à celui de ses protecteurs du Congrès américain ? Ne sait-il pas que les États-Unis détiennent le record du taux d'incarcération le plus élevé au monde : 629 détenus pour 100 000 habitants ? À comparer avec la Chine qui compte 121 détenus pour 100 000 habitants. Quand il ajoute : « Une chose est sûre, aucun régime totalitaire, qu'il soit dirigé par un individu ou un parti, ne peut durer éternellement »: est-ce à Donald Trump, le nouveau dictateur de l'impérialisme mondial, que ce mot est adressé +?
Et quand il parle de la possibilité de créer « une paix durable », sait-il qu'il s'adresse au pays le plus belliqueux de la planète ? Les guerres déclenchées par les USA depuis le début du 21ème siècle, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, ont causé la mort de plus trois cent mille civils et jeté 26 millions de réfugiés sur les routes ; sans parler de leur implication dans le désastre causé au peuple palestinien, avec plus de 40.000 morts. Quant à la Chine, elle a réussi en 40 ans à sortir de la pauvreté extrême les 800 millions de personnes les plus démunies du pays.
Finalement, on se demande dans quel monde est resté coincé le dalaï-lama.
Faut-il lui rappeler que, historiquement, à chaque changement de dynastie, l'empereur choisissait une autre école bouddhiste pour représenter officiellement le Tibet ? La dynastie Yuan (1271-1368) avait opté pour l'école Sakya (fondée au 11ème siècle), la dynastie Ming (1368-1644) s'est tournée vers une des branches de l'école Karma-Kagyu (aussi fondée au 11ème siècle), les Qing (1644-1912) ont choisi l'école Gelug (fondée au début du 15ème siècle). Si l'on se rapporte à cette tradition, le dalaï-lama aurait dû perdre son droit de représenter le Tibet dès 1912, et Sun Yatsen aurait dû choisir une autre école du bouddhisme tibétain dès le début de la République de Chine1. Cela n'a pas été fait, mais il n'est pas trop tard, même si les temps ont changé.
Aujourd'hui, comme solution au problème de la succession du dalaï-lama beaucoup d’intellectuels tibétains de la RAT préconisent que les Tibétains désignent eux-mêmes deux représentants pour chacune des cinq écoles bouddhistes principales : Nyingma (fondée 8ème siècle), Kagyu, Sakya, Gelug et le Bön qui a été rajouté aux quatre écoles traditionnelles du bouddhisme tibétain par le 14ème dalaï-lama en personne. De cette manière serait fondé un comité qui pourrait résoudre démocratiquement les questions religieuses du Tibet. Dans ce système, le dalaï-lama deviendrait un simple membre du comité bouddhiste et perdrait automatiquement son pouvoir politique. Cela permettrait de résoudre à la fois la « question tibétaine » et la succession du dalaï-lama : une solution élégante de laquelle tout le monde sortirait gagnant.... sauf le clergé et l'élite des Tibétains en exil qui gardent le vain espoir de retrouver une certaine autorité sur le Tibet. Auraient-ils oublié que, finalement, ils ne représentent que 0,2% de l'ensemble de la population tibétaine ?
Source :
1 République de Chine (1912-1949) : Sun Yatsen en fut le fondateur et le premier président, puis la présidence fut reprise par la Tchang Kai-Tchek (1887-1975), militaire anticommuniste à la tête du Kuomintang, président nationaliste de Taïwan jusqu'à sa mort